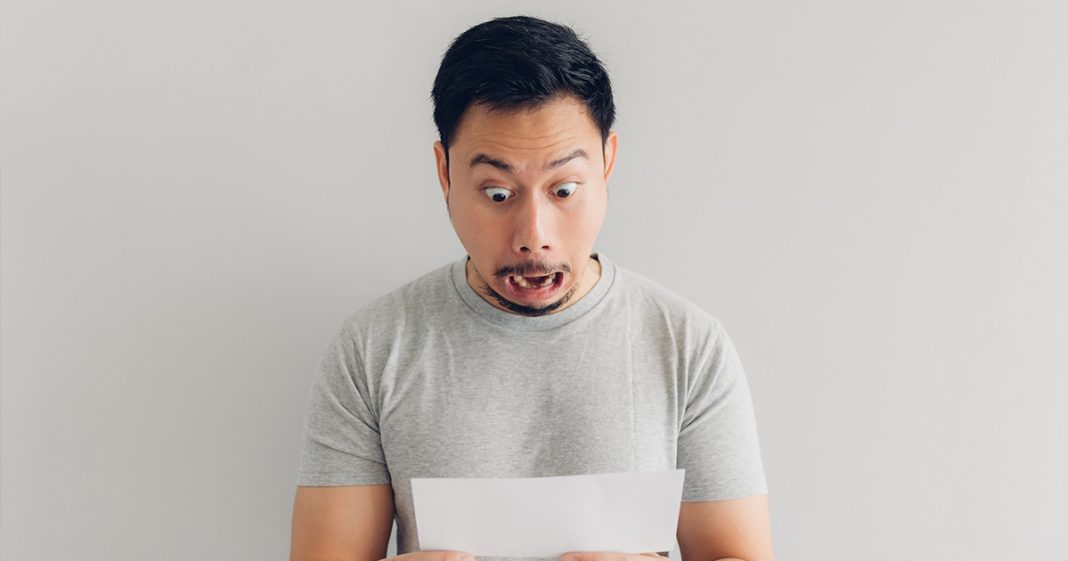Depuis quelques semaines, la question de la droite et de sa place dans l’espace public québécois revient dans le débat. Elle mérite mieux qu’un échange de qualificatifs. Elle suppose qu’on clarifie d’abord notre vocabulaire, qu’on examine ensuite nos réflexes médiatiques, et qu’on reconnaisse enfin les contraintes culturelles qui façonnent notre discussion politique.
De quelle « droite » parle-t-on?
Dire que « la droite » a pris de la place au Québec n’a de sens que si l’on précise de quelle droite il s’agit. Il y a, schématiquement, deux axes qui se superposent et qu’on confond trop souvent :
- un axe identitaire (national/conservateur ↔ cosmopolite/progressiste),
- un axe institutionnel-économique (état fort/intervention ↔ liberté individuelle/État limité).
La droite nationale opère surtout sur le premier axe : elle parle de mœurs, d’appartenance, de continuité culturelle. Elle a trouvé des relais — politiques, médiatiques, communautaires — parce qu’elle mobilise un langage collectif familier au Québec : celui du « nous ». À l’inverse, la droite libérale classique intervient sur le second axe : elle met l’accent sur la liberté de choix, la responsabilité, la concurrence institutionnelle, les mécanismes impersonnels (règles, marchés, contre-pouvoirs). Elle s’exprime dans une grammaire moins intuitive ici, car elle décentre le « nous » au profit de l’individu et des règles.
Cette asymétrie explique en partie pourquoi l’une paraît visible et l’autre demeure marginale. Le Québec a bâti son récit moderne sur l’idée d’un État-outil, garant de la promotion collective. Dans ce contexte, la proposition libérale classique — limiter l’État pour libérer des interactions volontaires — ressemble moins à un projet identitaire qu’à une discipline institutionnelle. Elle attire moins l’attention parce qu’elle est anti-spectaculaire : elle promet des processus plus que des symboles.
Le malentendu de la « rigueur budgétaire »
Beaucoup de figures étiquetées « à droite » sont en réalité des sociaux-démocrates soucieux de rigueur budgétaire. Ce n’est pas trivial, mais ce n’est pas non plus un basculement philosophique. La rigueur peut n’être qu’un managérialisme appliqué à un État qui, par ailleurs, conserve les mêmes finalités et la même envergure. Autrement dit, on améliore la carrosserie sans changer le moteur.
La droite libérale classique, elle, ne se contente pas d’équilibrer un budget : elle interroge ce que l’État fait, pourquoi il le fait, et ce qu’il devrait cesser de faire pour laisser place à l’initiative. Réduire la droite à la seule probité comptable revient à confondre un moyen (bien gérer) avec une fin (maximiser la liberté et la responsabilité).
Le biais médiatique du « zèbre de droite »
Je reconnais qu’on voit, depuis quelques années, un certain effort pour offrir sporadiquement une tribune à des voix plus franchement à droite. Mais ce geste demeure souvent curatorial : on expose la différence comme on expose un zèbre. On l’invite pour son contraste plus que pour sa cohérence programmatique. Cette « fenêtre de tir » ritualisée produit un effet paradoxal : elle confirme la diversité tout en la confinant.
Le format médiatique favorise l’angle qui polarise (identité, clashs symboliques) au détriment de l’angle qui institutionnalise (règles du jeu, incitations, droits de propriété, concurrence des solutions). Or, la droite libérale vit et meurt dans cette seconde dimension, moins télégénique, mais plus structurante.
Le sentiment militant de marginalité : une constante humaine
Comme n’importe quel militant, ceux de la « droite de Québec » jugent que leur cause est sous-représentée. C’est un phénomène assez universel : chaque courant minoritaire dans le système de distribution de l’attention a l’impression d’être bâillonné. Deux illusions s’entretiennent :
- • l’illusion de la majorité morale (« nos idées sont de bon sens, donc forcément majoritaires », tsé la fameuse majorité silencieuse),
- • l’illusion de la conspiration de l’attention (« si on ne nous entend pas, c’est qu’on nous censure »).
En réalité, il existe surtout une économie de l’attention qui récompense le fracas, la narration identitaire et l’indignation immédiate. La pensée institutionnelle, elle, demande du temps long, de la patience argumentative et… des auditeurs prêts à écouter. C’est moins rare qu’on le croit, mais c’est plus diffus que les algorithmes ne le laissent paraître.
Les « pirates » : d’un nom de communauté à une caricature
Cela nous amène au cas particulier des « pirates », associés à Jeff Fillion. Le terme, à l’origine, désignait simplement les auditeurs de Radio Pirate, une radio Web qui a pivoté vers le podcast. Une communauté s’est formée avec ses codes, son humour, ses façons de débattre. Avec le temps, l’étiquette a été récupérée à l’extérieur pour désigner de manière péjorative certains éléments plus insistants et irrespectueux de l’auditoire — bref, une caricature.
Or je ne me « considère » pas pirate : je le suis, au sens classique du terme — auditeur et membre d’une communauté médiatique distincte — et non au sens caricatural qui réduit les gens à une masse bruyante et uniforme. Oui, il m’arrive d’être irrévérencieux. Mais figer l’ensemble dans un stéréotype, c’est refuser de voir sa diversité réelle.
C’est pourquoi l’ostracisme me semble contre-productif. Exclure, c’est radicaliser. La seule voie sérieuse est l’engagement : écouter les frustrations, reconnaître la part de vrai, montrer en quoi les craintes — légitimes — deviennent parfois des exagérations. Surtout, s’adresser à l’intelligence des personnes : elle existe, qu’on le veuille ou non.
Pourquoi la droite libérale progresse « un à un »
Le succès de la droite libérale ne viendra pas d’une opération médiatique massive. Les idées institutionnelles se propagent par capillarité, pas par raz-de-marée. L’allégorie de la caverne est éclairante : on ne libère pas les prisonniers en renversant les marionnettistes ; on accompagne chacun hors de la caverne, patiemment.
La liberté ne s’impose pas : elle se comprend. Elle est moins un slogan qu’une habitude de juger — apprendre à voir les coûts invisibles, les effets de second ordre, la supériorité souvent discrète des mécanismes volontaires sur les injonctions centralisées.
Ce type d’apprentissage est relationnel, incrémental, réversible. Il aime la conversation sincère plus que le triomphe oratoire.
En guise de conclusion
Si la droite nationale paraît plus visible, c’est qu’elle parle la langue chaude du collectif. Si la droite libérale paraît plus rare, c’est qu’elle propose une architecture froide, mais féconde des règles et des responsabilités.
La première mobilise, la seconde civilise. Nous avons besoin des deux dimensions pour comprendre nos débats, mais l’une est suramplifiée par notre écologie médiatique, l’autre est sous-entendue par notre culture politique.
La tâche qui attend la droite libérale n’est ni héroïque ni médiatique : elle est pédagogique. Et la pédagogie, par nature, se fait à hauteur d’homme — un visage, une discussion, un déplacement intérieur. C’est plus lent. C’est aussi plus durable.