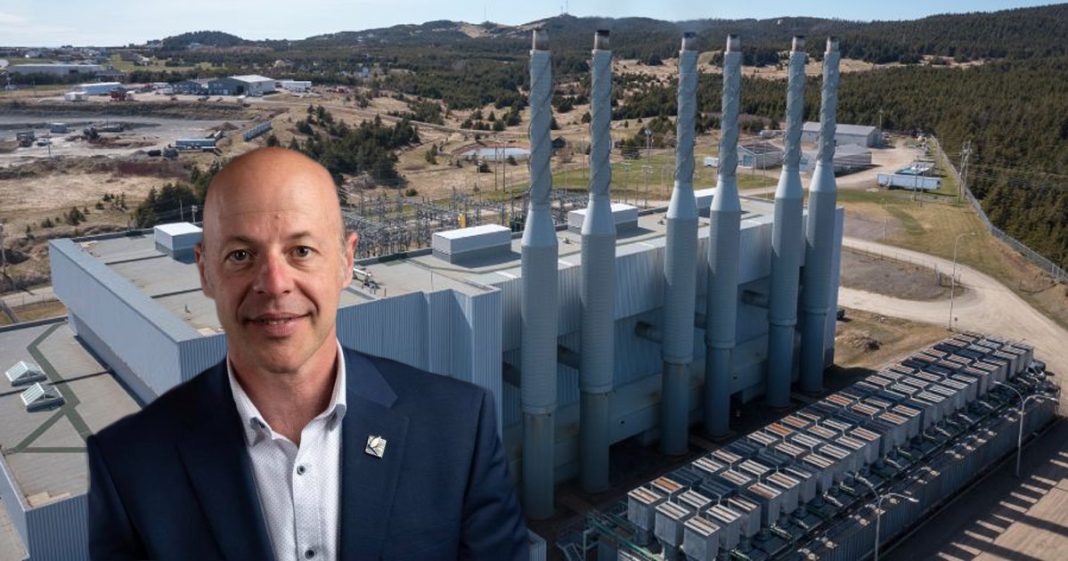Le gouvernement fédéral canadien frappe fort avec son projet de loi C-9, surnommé la « Loi visant à lutter contre la haine », déposé en première lecture le 19 septembre 2025. Cette initiative législative du ministre de la Justice bouleverse les règles du jeu en matière de propagande haineuse et pourrait bien redéfinir les limites de la liberté d’expression au Canada.
Une révolution juridique en cinq points
Le projet de loi C-9 transforme radicalement le Code criminel selon cinq axes majeurs. D’abord, il abolit l’exigence de consentement préalable du procureur général pour poursuivre les infractions de propagande haineuse, supprimant ainsi un filtre administratif qui existait depuis des décennies. Ensuite, le projet de loi criminalise « l’exposition dans un endroit public de certains symboles » visant à « fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable ».
Le projet de loi crée également une nouvelle catégorie de « crime haineux » pour toute infraction fédérale « motivée par de la haine fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre ». Il établit aussi des infractions spécifiques pour l’intimidation et l’obstruction d’accès aux lieux de culte, aux établissements d’enseignement et aux cimetières.
Des symboles interdits aux peines alourdies
Le projet de loi cible spécifiquement trois catégories de symboles : ceux « principalement utilisés par une entité inscrite » au sens de la loi antiterroriste, « la croix gammée ou [les runes SS] », et tout symbole « à ce point semblable » qu’il pourrait être « confondu » avec les précédents. Les contrevenants risquent jusqu’à deux ans d’emprisonnement pour acte criminel.
Les peines maximales montent lorsque l’infraction est qualifiée de « crime haineux » : cinq ans, dix ans, quatorze ans ou jusqu’à la perpétuité selon la gravité de l’infraction de départ.
Les défenses légitimes sous la loupe
Le législateur prévoit néanmoins certaines exceptions pour « un but légitime, notamment un but lié au journalisme, à la religion, à l’éducation ou aux arts et non contraire à l’intérêt public ». Le projet de loi autorise aussi l’exposition de symboles faite « de bonne foi dans le but d’attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine ».
Une précision cruciale stipule que « la communication de déclarations n’incite pas à la haine ou ne la fomente pas pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense ». Cette nuance pourrait s’avérer déterminante pour les critiques politiques, religieuses ou sociales.
Une définition restrictive de la haine
Le projet de loi définit spécifiquement la haine comme « un sentiment plus fort que le dédain ou l’aversion et comportant de la détestation ou du dénigrement ». Cette définition technique vise apparemment à distinguer la haine criminelle des simples désaccords ou critiques, mais son application pratique reste à démontrer devant les tribunaux.
Les zones grises qui inquiètent
Plusieurs aspects du projet soulèvent des questions épineuses. D’abord, l’abolition du consentement du procureur général peut faciliter certaines poursuites privées potentiellement abusives, supprimant un mécanisme de filtrage qui évitait les procès-spectacles. Cependant, un juge et le procureur peuvent encore bloquer les cas abusifs. Ensuite, la notion de symbole « à ce point semblable » qu’il pourrait être « confondu » avec les symboles proscrits introduit une subjectivité troublante dans l’application de la loi et risque d’amener des débats sur des cas limites.
L’expression « non contraire à l’intérêt public » pour les exceptions journalistiques, artistiques et éducatives reste floue et pourrait donner une marge d’interprétation considérable aux tribunaux. De même, l’évaluation de la « bonne foi » dans l’exposition de symboles à des fins critiques risque de créer une zone d’incertitude juridique.
Un projet encore loin du but
Le projet de loi C-9 vient tout juste d’être déposé le 19 septembre 2025. Ce n’est encore qu’un projet – pas une loi. Il doit maintenant passer par tout le processus parlementaire avant de devenir réalité, ce qui peut prendre des mois.
La disposition mentionnant une entrée en vigueur « le trentième jour suivant la date de sa sanction » ne s’appliquera qu’après l’adoption finale par le Parlement et le Sénat. En attendant, il y aura du temps pour débattre de cette réforme controversée.
Le projet de loi C-9 représente un tournant potentiel dans l’équilibre entre protection contre la haine et liberté d’expression. Les débats parlementaires à venir détermineront si cette législation sera adoptée, modifiée ou rejetée. Reste à voir comment évoluera ce projet ambitieux face aux enjeux constitutionnels et aux préoccupations qu’il soulève déjà.