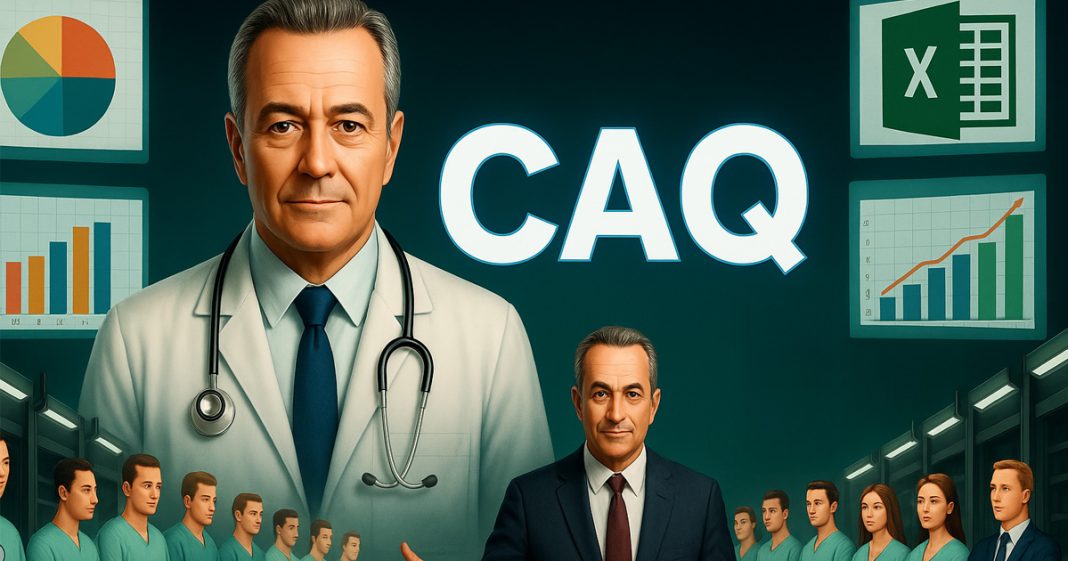L’Institut économique de Montréal (IEDM) propose une refonte majeure du système de santé québécois. Dans un manifeste signé par l’économiste Marcel Boyer, le think tank recommande une ouverture significative au secteur privé dans la prestation des soins, tout en maintenant le financement public universel.
Le message est clair : « Les systèmes de santé universels les plus performants au monde ne sont pas ceux qui accordent un monopole au secteur public », affirme le Dr Boyer dans le communiqué publié le 30 octobre. « Ce sont plutôt ceux qui appliquent les principes de concurrence pour placer le patient au cœur des décisions qui garantissent les meilleurs résultats ».
Le modèle canadien, une exception dans le monde développé
Le Canada se distingue parmi les économies développées avec son monopole gouvernemental qui limite légalement toute compétition dans la prestation des soins. Pendant que nos partenaires européens et asiatiques misent sur un mélange d’hôpitaux publics, privés à but lucratif et privés sans but lucratif, le Québec et les autres provinces maintiennent un modèle unique qui, selon l’IEDM, limite l’innovation et l’efficacité.
Les données européennes sont révélatrices. En France, les hôpitaux privés — lucratifs et non lucratifs — représentaient 55 % de l’ensemble des établissements hospitaliers en 2023 et comptaient pour 39 % des lits disponibles au pays. Le secteur à but lucratif français réalise 55 % des opérations chirurgicales, 42 % des soins médicaux et de réadaptation, et 22 % des hospitalisations en psychiatrie. Tous ces soins demeurent couverts par l’assurance publique universelle, comme au Québec.
L’Allemagne présente un portrait similaire : un tiers de ses hôpitaux sont privés à but lucratif et un autre tiers sont privés sans but lucratif, tous intégrés au système de santé public. Ces établissements traitent tous les patients sans distinction et reçoivent le même financement de l’assurance publique pour un même traitement.
Des ressources mal utilisées, pas insuffisantes
L’analyse de Boyer identifie deux problèmes structurels qui expliquent la sous-performance du système québécois. D’abord, l’accès gratuit aux soins sans mécanisme de régulation crée une demande illimitée qui dépasse les capacités du système.
Ensuite, la multiplication des droits de veto entre syndicats, ordres professionnels et gestionnaires publics bloque toute innovation. « En protégeant le secteur public de toute concurrence, notre système de santé a perdu les incitations à innover dans ses modes de gestion », soutient Boyer. « Comme la gouvernance n’a que très peu d’incitations à la performance, nous faisons aujourd’hui face à une situation où les importantes ressources qui y sont déployées ne sont gérées ni efficacement ni avec efficience ».
Autrement dit : le problème n’est pas le manque de ressources, mais leur utilisation inefficace.
Une répartition claire des responsabilités
La proposition de l’IEDM redéfinit les rôles de l’État et du secteur privé. L’État conserverait quatre missions stratégiques : déterminer les besoins en soins de santé de la population, répartir les ressources disponibles, financer les services, et superviser les contrats avec les prestataires.
Le secteur privé — comprenant entreprises, coopératives, organismes sans but lucratif et autres acteurs — serait responsable de la production et de la prestation des soins en mobilisant les meilleures technologies, le personnel qualifié et l’organisation optimale.
Cette séparation élimine les conflits d’intérêts qui affaiblissent le système actuel, où le gouvernement conçoit, finance, livre ET évalue les soins lui-même. Ces conflits créent « un climat propice aux arrangements de connivence, au manque de transparence et à l’octroi d’avantages indus à diverses parties prenantes aux dépens des patients et des contribuables ».
Concrètement, l’État cesserait de gérer directement les hôpitaux et signerait plutôt des contrats de performance avec différents établissements — publics, privés, coopératifs — en compétition pour offrir les meilleurs soins au meilleur coût.
Une réforme pragmatique et réalisable
Boyer identifie quatre défis de mise en œuvre.
Premier défi : négocier le réaménagement des rôles avec les syndicats de travailleurs et de professionnels, un obstacle « difficile, mais pas impossible à surmonter ».
Deuxième défi : concevoir des contrats de performance solides avec les prestataires privés, protégés contre la capture par des groupes d’intérêts.
Troisième défi : mettre en place des indicateurs rigoureux pour mesurer la performance des prestataires.
Quatrième défi : établir un niveau de compétition approprié entre les prestataires, ce qui nécessitera une communication claire sur les avantages de la concurrence pour améliorer les soins.
Le document insiste sur l’importance de comptabiliser correctement tous les coûts des infrastructures et équipements, pour démontrer que « les entreprises à but lucratif ne produisent pas nécessairement à des prix plus élevés que les entreprises publiques ou sans but lucratif ».
Une réforme pragmatique face à l’urgence
Le manifeste arrive alors que 160 000 Québécois attendent une chirurgie, dont 11 000 depuis plus d’un an. La proposition de l’IEDM s’appuie sur des modèles éprouvés : en France, en Allemagne et en Corée du Sud, la coexistence d’établissements publics et privés dans un système à financement public universel démontre qu’innovation et accessibilité ne sont pas incompatibles.
Dix-sept ans après le rapport Castonguay de 2008, qui suggérait déjà « une participation plus importante de prestataires privés », le diagnostic reste le même. La différence aujourd’hui : les listes d’attente s’allongent et les exemples internationaux se multiplient, offrant une feuille de route concrète pour une réforme qui placerait enfin le patient au centre du système.