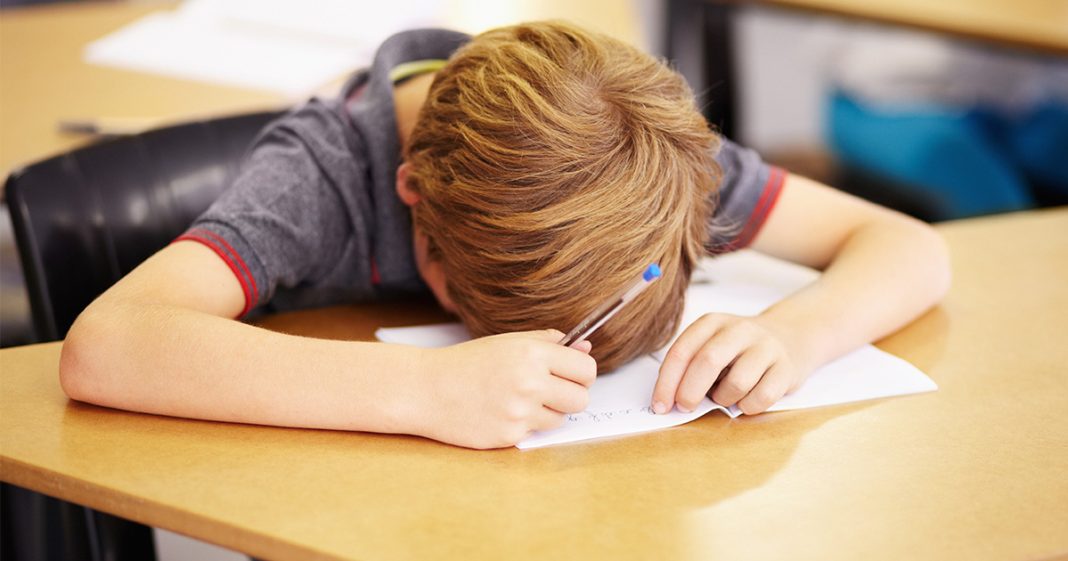Ce mardi 11 novembre à 11 heures, des milliers de Canadiens ont observé deux minutes de silence devant le Monument commémoratif de guerre. Cette tradition centenaire commémore l’armistice de 1918 et honore les sacrifices consentis pour défendre les libertés qui définissent le pays.
L’origine d’une date symbolique
Après quatre années de conflit, la Première Guerre mondiale avait dévasté le Canada. 61 000 soldats ne sont jamais revenus et 172 000 autres ont été blessés. Derrière ces chiffres se trouvaient des fils, des pères, des frères. La plupart avaient entre 18 et 25 ans. Des villages entiers ont perdu plusieurs hommes en quelques jours de combat.
C’est dans ce contexte que, le 11 novembre 1918 à 5h15, dans un wagon-restaurant de la forêt de Compiègne, l’armistice était enfin signé. Le cessez-le-feu entrait en vigueur à 11 heures. À cette heure précise, après 1 567 jours de guerre, les canons se taisaient. Le silence remplaçait le fracas des bombardements qui avait tué et mutilé toute une génération.
Vingt ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Entre 1939 et 1945, plus de 45 000 autres Canadiens sont morts en combattant le nazisme et les forces de l’Axe. Avec les victimes de la guerre de Corée, des missions de maintien de la paix et d’autres opérations militaires, le Canada a perdu 118 000 de ses citoyens au service du pays depuis 1914.
Depuis 1931, le 11 novembre à 11 heures, le pays observe deux minutes de silence à l’heure exacte où la paix est revenue en Europe en 1918.
Les valeurs au cœur du sacrifice
Les soldats canadiens ne combattaient pas pour des concepts abstraits. Ils défendaient des principes concrets qui structurent encore la société : la liberté, la démocratie et l’état de droit.
Préserver la liberté contre la domination totalitaire
Durant les deux guerres mondiales, le Canada s’est battu pour empêcher l’expansion de régimes autoritaires qui niaient les libertés fondamentales. Dans l’Allemagne nazie et les pays de l’Axe, les citoyens ne pouvaient s’exprimer librement, se réunir pacifiquement ou contester leur gouvernement sans risquer l’emprisonnement ou la mort.
Les monuments commémoratifs érigés après ces conflits représentent des figures allégoriques de la paix et de la liberté, symbolisant ces valeurs pour lesquelles tant de vies ont été sacrifiées.
Protéger un mode de vie et des traditions
Les soldats, comme l’exprime le Musée canadien de la guerre, « sont morts pour nous, pour leurs maisons et familles et amis, pour un ensemble de traditions qu’ils chérissaient et un avenir auquel ils croyaient ». Leur sacrifice visait à protéger non seulement le territoire, mais aussi le mode de vie démocratique et les valeurs canadiennes.
Les lettres envoyées du front témoignent de cette motivation profonde : protéger ceux qu’ils aimaient et le pays qu’ils connaissaient.
Défendre les droits humains et l’égalité devant la loi
Les sociétés démocratiques reposent sur des libertés civiles ancrées dans les traditions : la liberté d’expression, la liberté de réunion, la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable. Ces libertés protègent les citoyens contre l’arbitraire du pouvoir.
Les régimes totalitaires violaient systématiquement chacune de ces libertés. La liberté d’expression disparaissait sous la censure et la propagande d’État obligatoire. La liberté de réunion était abolie : toute association indépendante du régime était interdite, les manifestations réprimées violemment. Le droit à un procès équitable n’existait plus : les tribunaux d’exception condamnaient sans preuve, la présomption d’innocence était inexistante.
Les régimes nazis et fascistes confisquaient également les biens des citoyens par décrets, donnant une apparence légale à leurs spoliations. Dès avril 1938, les nazis forçaient les Juifs à enregistrer tous leurs biens avant de les confisquer. En France, Belgique et Pays-Bas occupés, plus de 70 000 logements ont été vidés. Le 5 janvier 1943, les Alliés réunis à Londres proclamaient leur intention « d’invalider tous les transferts ou transactions de propriété, qu’ils aient été réalisés par pillage ou sous des apparences légales ». Ces violations multiples démontraient comment les totalitarismes anéantissaient l’ensemble des protections démocratiques.
Vimy : le jour le plus meurtrier de l’histoire militaire canadienne
Ces valeurs démocratiques ne se sont pas défendues sans coût humain. La bataille de la crête de Vimy, du 9 au 12 avril 1917, illustre l’ampleur des sacrifices consentis pour les préserver. Cette position stratégique du nord de la France dominait les lignes alliées. Les forces françaises et britanniques avaient échoué à la prendre pendant deux ans, accumulant plus de 150 000 pertes.
Le 9 avril 1917 à 5h30, environ 15 000 fantassins canadiens sortaient des tranchées dans la première vague. Les quatre divisions du Corps canadien attaquaient ensemble pour la première fois, protégées par un barrage d’artillerie roulant. La préparation avait été méticuleuse : chaque soldat connaissait ses objectifs, des maquettes du terrain avaient été construites, et plus d’un million de munitions avaient pilonné les positions allemandes.
Les Canadiens réussirent là où d’autres avaient échoué. En quatre jours, la crête était prise. Le coût fut considérable : 10 602 victimes, dont 3 598 morts et 7 004 blessés. Le 9 avril 1917 reste le jour le plus meurtrier de l’histoire militaire canadienne.
Cette victoire transforma la perception du Canada sur la scène internationale. Le brigadier-général A.E. Ross déclara après la bataille : « Au cours de ces quelques minutes, j’ai été témoin de la naissance d’une nation ». En 1919, le pays signa le traité de Versailles comme nation souveraine, non plus comme simple dominion britannique.
Le coquelicot : un poème né du chagrin
Le coquelicot rouge porté en novembre a une histoire profondément personnelle. En mai 1915, le lieutenant-colonel John McCrae, médecin militaire de Guelph en Ontario, perd son ami le lieutenant Alexis Helmer lors de la deuxième bataille d’Ypres.
Le lendemain des funérailles, assis à l’arrière d’une ambulance de campagne, McCrae remarque que les coquelicots sauvages poussent abondamment sur les tombes fraîches. Dans ce moment de deuil, il compose « In Flanders Fields » (« Au champ d’honneur »), qui deviendra l’un des poèmes les plus célèbres de la langue anglaise.
Le poème débute ainsi : « Au champ d’honneur les coquelicots sont parsemés de lot en lot auprès des croix ». En 1921, le coquelicot devient le symbole officiel du Souvenir dans tout le Commonwealth.
Une mémoire transmise
La cérémonie d’aujourd’hui à Ottawa a marqué le centenaire de l’Aviation royale du Canada avec un défilé aérien d’avions d’époque, chaque appareil honorant la mémoire d’un vétéran. Des cérémonies similaires ont eu lieu devant les cénotaphes de toutes les régions, où des milliers de coquelicots ont été déposés.
Le jour du Souvenir maintient vivant le lien entre le passé et les valeurs qui structurent la société canadienne contemporaine. Les libertés démocratiques, acquises et défendues au prix de sacrifices considérables, constituent l’héritage transmis de génération en génération depuis cet armistice de 1918.