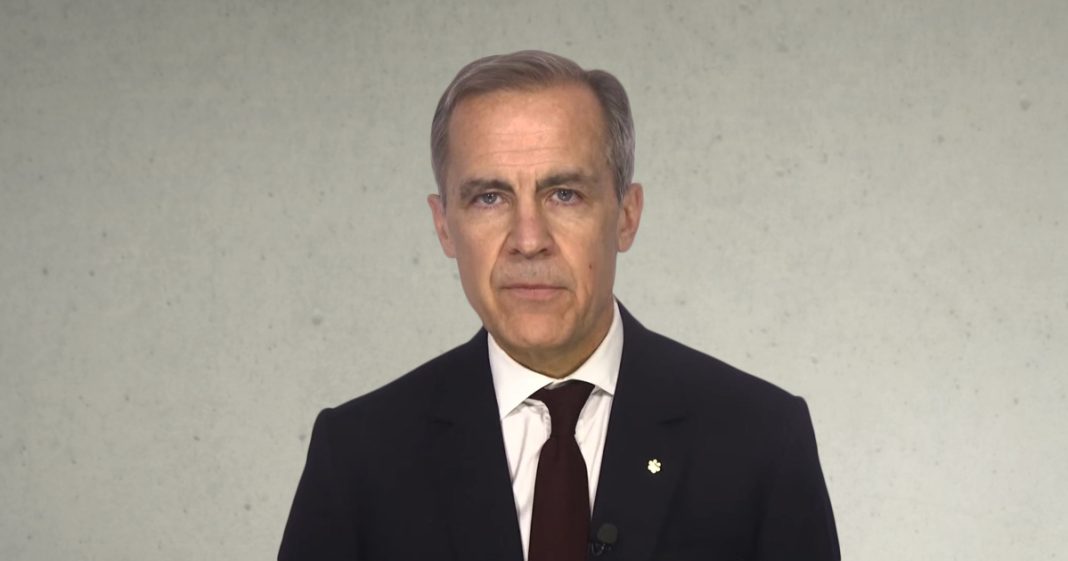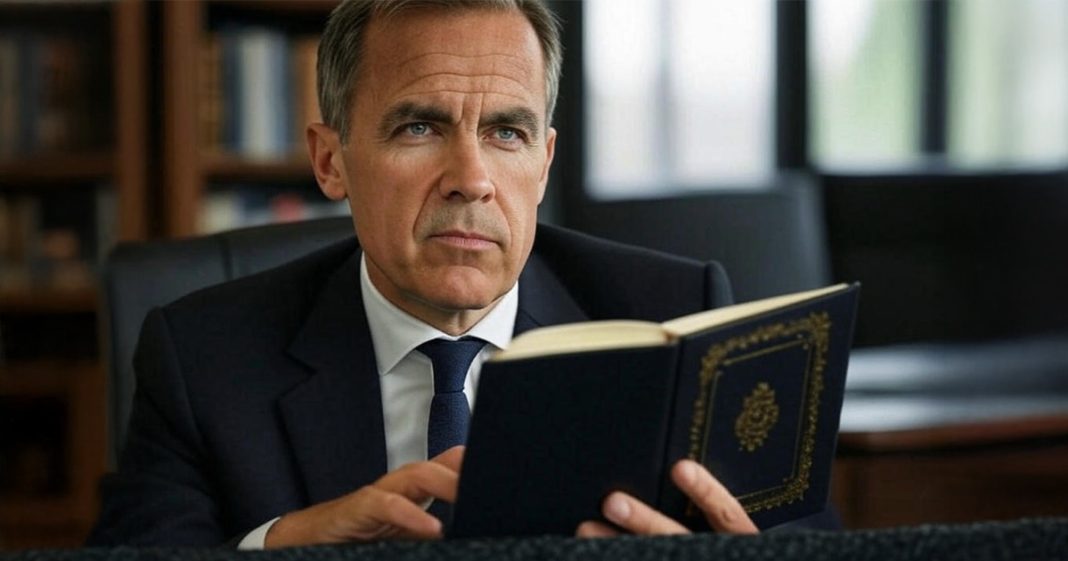Anatomie d’un budget planifié (Gouvernement Carney I, budget 2025)
Le slogan est si solennel qu’il en devient comique : « Bâtir un Canada fort. » Voilà donc le cri de ralliement du gouvernement Carney-Trudeau, car on ne sait plus trop lequel des deux conduit réellement le camion. Sous couvert de « résilience », de « souveraineté » et d’« investissements historiques », le budget 2025 se présente comme une épopée nationale. En réalité, c’est un manifeste de dirigisme économique, un traité d’ingénierie étatique emballé dans du populisme patriotique.
À le lire, on croirait que le Canada s’apprête à construire des pyramides, à crédit évidemment, pour prouver sa force à un monde ingrat.
La nouvelle liturgie du Canada fort
Dès le préambule, le ton est donné. L’État se prend pour l’Histoire :
« Nous ne faisons pas face à une transition, mais à un changement de portée historique. »
Ce que le texte appelle « changement de portée historique », un économiste un peu plus lucide appellerait plutôt le contrecoup de vingt ans de politiques interventionnistes et d’endettement joyeux.
Mais dans le catéchisme Carney, tout devient matière à célébration : les crises sont des occasions, les déficits des investissements, et les restrictions budgétaires des actes de courage.
Cette « nouvelle ère de leadership » n’est pas celle du risque entrepreneurial ou de la liberté d’échanger : c’est celle du retour triomphal de la politique industrielle. Le gouvernement avoue lui-même que plus de 2500 mesures de ce type ont été adoptées dans le monde en 2024.
Et comme à chaque fois que la planète s’enfonce dans le protectionnisme, Ottawa se précipite pour imiter les pires.
Carney, l’homme qui aimait planifier
Mark Carney n’a jamais été un économiste au sens libéral du terme : c’est un banquier central devenu prêtre de la vertu planifiée. On lui doit cette idée magique que les « investissements publics structurants » peuvent remplacer la productivité réelle. Sous sa houlette, les concepts d’« innovation » et d’« entrepreneuriat » signifient en pratique : crédits d’impôt, superdéductions et subventions ciblées par l’État. Bref, du capitalisme d’amis dans sa forme la plus policée.
La superdéduction à la productivité, par exemple, est présentée comme un miracle fiscal :
« Favoriser la productivité et la compétitivité »
En vérité, il s’agit d’une énième mécanique d’ingénierie comptable pour permettre aux grandes entreprises connectées et aux industries « stratégiques » de récupérer ce qu’on leur a prélevé la veille.
Pendant ce temps, les PME, qui ne disposent ni de lobby ni de département fiscal, continueront à financer les mégaprojets fédéraux baptisés Maisons Canada, Bureau des grands projets ou Agence de l’investissement pour la défense. On n’a pas vu un tel foisonnement de comités depuis l’époque où l’Union soviétique se donnait pour mission de « planifier la productivité du blé ».
La schizophrénie de la rigueur
« Dépenser moins pour investir davantage », proclame le document sacré du banquier monotone.
C’est un chef-d’œuvre d’oxymore budgétaire. Dans le même paragraphe, Ottawa promet de « réduire la taille du gouvernement », de « moderniser la fonction publique » et d’« investir 280 milliards sur cinq ans ».
Autrement dit : on va économiser en empruntant plus.
Le budget parle de « rigueur » tout en annonçant un déficit de 78 milliards pour 2025-2026, et de 65 milliards pour l’année suivante.
Mais attention : ces déficits, précise-t-on, sont « bons », car ils financent l’avenir
La dette, elle, n’est plus une contrainte : c’est une capacité d’action. À ce compte, un ménage surendetté devrait remercier sa carte de crédit d’assurer sa « résilience intergénérationnelle ».
On retrouve ici la logique keynésienne la plus paresseuse, celle qu’un libéral authentique réfute depuis des décennies : l’idée que l’État dépense mieux que l’individu. La prospérité n’y vient plus du travail ou de l’innovation, mais d’une variable Excel sur le Bureau des grands projets.
L’économie d’État en habit de gala
Les 400 pages du document budgétaire sont une ode à la substitution de la société civile par la machinerie fédérale. Le Canada n’y est plus une confédération de provinces et d’entreprises libres, mais une start-up étatique de 40 millions d’actionnaires captifs. Tout y passe : logement, défense, jeunesse, culture, égalité des genres, ports, aéroports, télécoms, intelligence artificielle, minéraux critiques. Chaque domaine reçoit sa « stratégie » et son « fonds ». L’économie n’est plus un organisme vivant : c’est un organigramme.
Le mot « investissement » apparaît plus de 400 fois, mais le mot « marché » à peine une poignée. Le marché libre, ce moteur qu’on dit usé, est remplacé par l’« approche intégrée ». Et bien sûr, la « transition énergétique », ce puits sans fond du subventionnisme contemporain, devient l’axe central de la productivité canadienne. Carney ne promet rien de moins qu’une « superpuissance énergétique propre ». Il n’y a qu’un détail : personne ne sait encore produire de l’hydrogène à coût compétitif.
L’État bâtisseur : du mythe à la mégalomanie
Le budget évoque avec lyrisme « les grands projets d’intérêt national qui relieront nos régions »
On y sent poindre la nostalgie d’un Canada du XIXe siècle, celui du chemin de fer et de la route Transcanadienne. Mais à la différence de l’époque, l’État n’a plus d’or, seulement des promesses d’emprunts.
Le parallèle avec les années 1940 et 1990, que le ministre invoque dans son avant-propos, est d’un ridicule achevé :
« Tout comme les Canadiens se sont mobilisés pour défendre la liberté… nous devons nous mobiliser aujourd’hui pour bâtir le pays. »
Comparer la lutte contre le nazisme ou la rigueur budgétaire de Chrétien à un plan d’infrastructures financé par la Banque de l’inflation relève du théâtre politique. C’est confondre le courage avec le crédit.
Le mythe de la classe moyenne protégée
Autre passage d’anthologie :
« Réduire les impôts pour la classe moyenne et éliminer la tarification du carbone pour les consommateurs. »
C’est le genre de promesse qui sent la poudre de perlimpinpin. On supprime une taxe verte à la pompe pour en créer dix autres sous forme de redevances cachées, de normes de production, de quotas et de crédits d’impôt partisans. Le carbone ne sera plus tarifé : il sera administré. Et l’économie, elle, sera tout aussi asphyxiée, mais cette fois sous le label de compétitivité climatique.
Quant à la « réduction d’impôt » vantée pour 22 millions de Canadiens, elle est financée par des déficits chroniques que les mêmes paieront demain sous forme d’inflation, de stagnation salariale et de taux d’intérêt élevés. La gauche adore réduire les impôts qu’elle s’empresse ensuite de rehausser par la dette.
Le logement, nouvelle religion fédérale
Le chapitre Maisons Canada est une leçon de paternalisme économique. Ottawa promet de construire 430 000 à 480 000 nouveaux logements par année, soit deux fois plus que la capacité actuelle du marché.
Mais l’État, bien sûr, ne construit rien : il empile des programmes. Il parle d’« attirer des capitaux privés », mais il les attire par contrainte, en fixant les critères, les loyers et la planification régionale. Ce n’est plus du partenariat public-privé : c’est du socialisme soft.
Et parce que l’imagination n’a plus de limite, Maisons Canada promet de réduire les coûts de 20 % et les délais de 50 % grâce à la « construction modulaire » et à « l’adoption généralisée de méthodes avancées ». Voilà la solution : remplacer les grues par des PowerPoint.
La souveraineté comme justification universelle
Le mot « souveraineté » traverse tout le document comme une incantation. Il justifie tout, de la politique industrielle à la censure culturelle.
« Défendre notre souveraineté grâce à des investissements historiques dans la défense nationale, la sécurité et les capacités dont nous avons besoin pour protéger les Canadiens. »
Traduction : on va dépenser 30 milliards pour une armée qui peine à remplacer ses hélicoptères, tout en lançant une « Agence de l’investissement pour la défense ». Il fallait oser marier le lexique militaire à celui du capital-risque. Bientôt, on parlera de « rendement opérationnel du patriotisme ».
Le pire est que cette rhétorique guerrière se double d’un moralisme moraliste : « protéger la culture », « investir dans l’identité canadienne », « soutenir CBC/Radio-Canada », « financer l’égalité des genres ».
Autant de façons d’habiller en vertu la vieille habitude de subventionner les clientèles électorales.
Le Canada fort… et dépendant
Derrière les grandes phrases, tout est contradictoire. Le gouvernement parle d’« autonomie énergétique » tout en multipliant les barrières réglementaires qui découragent l’exploitation pétrolière. Il vante les « marchés mondiaux » tout en ressuscitant la politique d’achats locaux :
« Grâce à notre politique “Achetez canadien”, nous renforcerons nos chaînes d’approvisionnement. »
C’est le protectionnisme le plus banal, maquillé en patriotisme économique. Or l’histoire est claire : aucun pays n’est devenu riche en se fermant. Les nations prospèrent quand elles commercent librement, pas quand elles érigent des murs tarifaires et des agences de coordination.
Cette obsession de « devenir notre meilleur client » révèle une incompréhension profonde de la spécialisation économique. Un pays ne se nourrit pas de lui-même : il échange. Se dire « autosuffisant » au XXIe siècle, c’est comme se vanter d’avoir coupé son Wi-Fi pour mieux réfléchir à l’avenir numérique.
La foi dans la dette
Le budget 2025 est une leçon de théologie financière. Le ratio dette/PIB est devenu un totem, un objet de fierté nationale : 13,3 %, nous répète-t-on, « le plus faible du G7 ».
On oublie seulement de préciser que ce chiffre n’inclut pas la dette provinciale, ni les passifs non capitalisés, ni les promesses futures. Additionnez tout, et la réalité est moins reluisante : le Canada est l’un des pays les plus endettés par habitant du monde développé.
Mais qu’importe, l’illusion fonctionne. On peut continuer à emprunter, à « investir », à se vanter d’une rigueur qui n’existe plus. Les libéraux des années 1990 auraient trouvé cela grotesque.
Aujourd’hui, c’est la norme. Le déficit est devenu un instrument de branding.
Quand l’État se prend pour une entreprise
L’un des passages les plus révélateurs est celui qui promet « une fonction publique allégée et plus productive » grâce à « l’adoption de l’intelligence artificielle à grande échelle ».
On en rirait si ce n’était pas écrit noir sur blanc. L’administration fédérale, gonflée de 30 % depuis 2019, promet de se réinventer grâce à l’IA. C’est un peu comme si un alcoolique expliquait qu’il allait devenir sobre en distillant lui-même son whisky. Carney a compris que pour justifier l’expansion de l’État, il faut le présenter comme une entreprise innovante. On ne parle plus de fonctionnaires, mais de « talents ». On ne fait plus de subventions, mais des « investissements de capital humain ». Le socialisme 3.0 parle la langue des start-up.
L’illusion de la rigueur morale
Le texte regorge de citations de Kristalina Georgieva, directrice du FMI, saluant « les bons choix du Canada ». Le compliment est d’autant plus ironique que le FMI a passé les vingt dernières années à avertir les pays contre ce genre de dérive interventionniste. Mais voilà, dans le monde Carney-Trudeau, tout s’inverse : la dette devient vertu, la dépense devient prudence, la planification devient innovation.
Et pour couronner le tout, on cite l’« avantage canadien » : la main-d’œuvre la plus instruite du monde, un environnement fiscal compétitif, la stabilité démocratique. C’est vrai, mais ce sont précisément les fruits d’un capitalisme libéral qu’on s’emploie désormais à neutraliser. Ce qui a fait la force du Canada, ce n’est pas l’État stratège, c’est la liberté d’entreprendre, l’ouverture des marchés, la responsabilité individuelle.
Tout ce que ce budget combat.
Carney, le Trudeau plus sérieux
Mark Carney incarne la mutation du progressisme économique : la technocratie morale.
Moins flamboyant que Trudeau, mais tout aussi convaincu que l’État sait mieux que vous comment dépenser votre argent.
Là où Trudeau vendait de l’émotion, Carney vend du sérieux. Mais le résultat est identique : un pays de plus en plus administré, dépendant, centralisé, et un secteur privé qui sert de vache à lait à la planification fédérale.
Les libéraux classiques avaient au moins le mérite de croire à l’équilibre budgétaire et à la responsabilité fiscale. Le libéralisme carnéen, lui, croit à la gestion par objectifs. On ne réduit plus les déficits, on les « optimise ». On ne crée plus des richesses, on « stimule des initiatives ». On ne parle plus d’individus libres, mais de « Canadiens et Canadiennes mobilisés ». Le vocabulaire bureaucratique a remplacé la langue de la liberté.
Bref : le Canada fort, ou la faiblesse institutionnalisée
Le budget 2025 ne construit pas un Canada fort : il bâtit un État dépendant, surendetté, convaincu de sa vertu.
Ce n’est pas un plan économique : c’est un poème d’autosatisfaction. Là où les vrais libéraux voient la prospérité dans le risque et la diversité, le carnéisme voit la sécurité dans la planification. Là où le marché trouve l’équilibre, l’État crée la dépendance. Et là où le citoyen cherche la liberté, le gouvernement répond par des programmes.
« Bâtir un Canada fort », dit le slogan. Mais plus l’État bâtit, moins les Canadiens sont libres de construire par eux-mêmes. Et c’est peut-être là, dans cette confusion volontaire entre la nation et le gouvernement, que réside la véritable fragilité de ce pays.
_______________________________________________________
Samuel Rasmussen –
« L’économie n’a pas besoin d’un père. Elle a besoin d’air. »