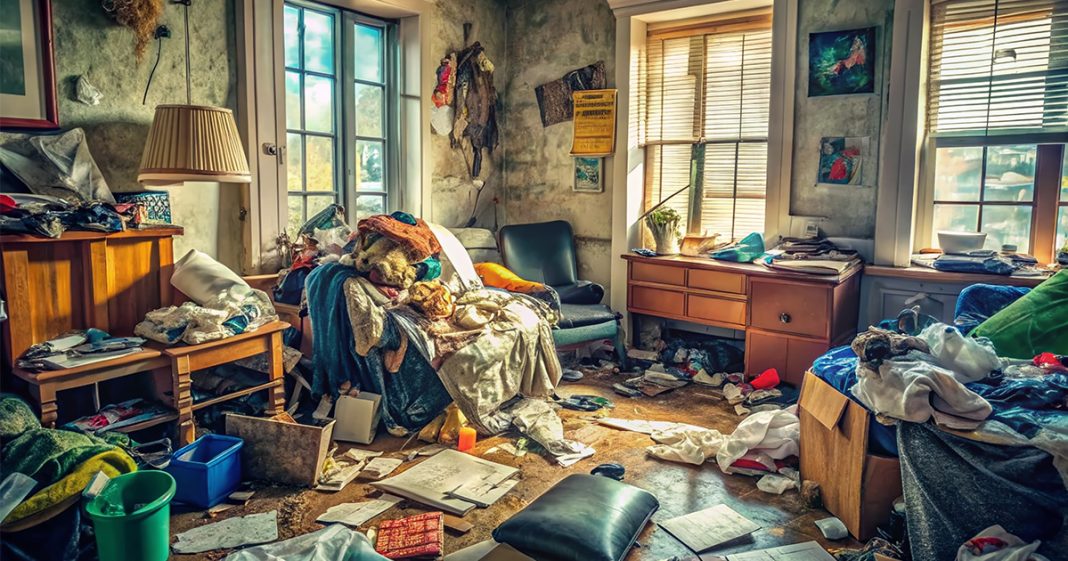Le fédéralisme canadien fonctionne mieux quand chaque palier de gouvernement reste dans son couloir constitutionnel, conclut une étude explosive du Fraser Institute publiée en octobre 2025. Les auteurs John Ibbitson, journaliste chevronné, et Livio Di Matteo, économiste réputé, affirment que les intrusions d’Ottawa dans les juridictions provinciales ont plongé la fédération dans ses pires tensions depuis le référendum québécois de 1995.
Des dépenses qui explosent et une facture pour les contribuables
Les dépenses fédérales dans des secteurs normalement gérés par les provinces ont explosé au cours des neuf dernières années, bien au-delà de l’inflation. Entre 2015 et 2024, l’étude révèle une augmentation spectaculaire de 1 741% des dépenses fédérales en réduction de la pollution, un domaine pourtant partagé entre Ottawa et les provinces. Pour mettre en perspective : l’inflation cumulée au Canada entre 2015 et 2024 était d’environ 28%.
Plus troublant encore pour les provinces : les dépenses fédérales en éducation primaire et secondaire — un champ de compétence exclusivement provincial selon la Constitution — ont bondi de 201% durant la même période de neuf ans. Pour les contribuables canadiens, cela signifie qu’Ottawa taxe pour financer des programmes dans des domaines où le Québec, l’Ontario et les autres provinces ont déjà leurs propres programmes et leurs propres taxes.
Les transferts fédéraux aux provinces, toujours assortis de conditions imposées par Ottawa, ont atteint 100,2 milliards de dollars en 2023-2024, soit une hausse de 59% comparativement à 2014-2015. Pendant ce temps, les dépenses totales de programmes fédéraux ont augmenté de 84% sur cette période de neuf ans — trois fois le taux d’inflation. Les dépenses de défense militaire, une responsabilité qui relève clairement du fédéral, n’ont grimpé que de 43%, à peine plus que l’inflation.
En données réelles ajustées pour l’inflation et la croissance de la population, les dépenses fédérales totales par habitant ont tout de même augmenté de 25% entre 2015 et 2024. Chaque dollar de dépense supplémentaire provient ultimement des poches des contribuables canadiens, que ce soit par les impôts directs, les taxes indirectes ou l’endettement public qui devra être remboursé.
L’ère Trudeau : un retour aux vieilles tensions
Les auteurs désignent l’ère Justin Trudeau, qui s’est échelonnée de 2015 à 2024, comme responsable de cette dérive. Les tentatives fédérales de créer des programmes pancanadiens — garderies subventionnées, taxe sur le carbone, réglementations environnementales étendues — ont ravivé les flammes séparatistes au Québec et alimenté l’aliénation de l’Ouest canadien.
Selon les auteurs, le mépris de Justin Trudeau pour le respect des juridictions constitutionnelles a créé les pires divisions au sein de la fédération canadienne depuis le référendum de 1995, quand le Québec a frôlé la séparation.
L’étude contraste cette approche avec celle de Stephen Harper, dont la décennie au pouvoir entre 2006 et 2015 s’est caractérisée par un fédéralisme passif qui a généré moins de tensions fédérales-provinciales qu’à n’importe quel moment depuis la Seconde Guerre mondiale. Harper a même augmenté les transferts aux provinces sans imposer de nouvelles conditions, réduisant ainsi le déséquilibre fiscal dénoncé par Québec.
Quand les provinces ripostent
Les réactions provinciales témoignent de l’ampleur du malaise. Au Québec, le Bloc Québécois, presque éteint en 2011 avec seulement 4 sièges à Ottawa, a resurgi en 2019 pour décrocher 32 sièges après quatre années d’intrusions fédérales dans les juridictions québécoises. Le Parti Québécois, désormais en tête des sondages provinciaux, promet un référendum sur la souveraineté s’il est élu.
En Alberta et en Saskatchewan, les gouvernements de Danielle Smith et Scott Moe ont adopté des lois sur la souveraineté interdisant l’ingérence fédérale dans leurs champs de compétence. Moe a refusé de remettre une portion de la taxe fédérale sur le carbone, tandis que Smith a assoupli les conditions pour déclencher des référendums, y compris sur la séparation.
Un déséquilibre fiscal vieux de 158 ans
L’analyse historique révèle que ce déséquilibre remonte à la fondation même du pays en 1867. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique a créé une structure où les provinces ont hérité de responsabilités coûteuses — santé, éducation, services sociaux — mais de sources de revenus limitées. Le fédéral, lui, dispose de sources de revenus élastiques qui croissent avec l’économie, notamment les impôts sur le revenu des particuliers et des entreprises.
En 1870, trois ans après la Confédération, les provinces représentaient 34% des dépenses gouvernementales totales, les municipalités 44%, et le fédéral seulement 22%. En 2015, après des décennies d’évolution, la part fédérale était revenue à son niveau de 1867, mais l’ère Trudeau a inversé cette tendance : entre 2015 et 2023, la part fédérale des dépenses est passée de 26,5% à 29,2%, tandis que la part provinciale a diminué de 51,3% à 49,9%.
Des intrusions dans les champs de compétence provinciaux
L’étude documente systématiquement où le fédéral dépense son argent entre 2015 et 2023, révélant des augmentations massives dans plusieurs domaines.
Dans les vraies intrusions provinciales, les chiffres sont éloquents. L’éducation primaire et secondaire — un champ de compétence exclusivement provincial — a vu les dépenses fédérales bondir de 201% en neuf ans, passant de 1,3 milliard à 3,9 milliards. Le logement, une compétence partagée mais largement provinciale, a explosé de 166%, grimpant de 1,9 milliard à 5,2 milliards.
Du côté des responsabilités fédérales légitimes, les dépenses ont aussi explosé. Les programmes de protection sociale — qui incluent notamment 23,3 milliards pour les services à l’enfance des Premières Nations et 10 milliards pour les annuités du traité Robinson-Huron — ont bondi de 761%, passant de 5,7 milliards en 2015 à 49,1 milliards en 2023. Ces dépenses pour les communautés autochtones relèvent de la compétence fédérale exclusive selon l’article 91(24) de la Constitution, mais elles illustrent néanmoins l’explosion des coûts fédéraux.
L’approvisionnement en eau, surtout pour les communautés autochtones, a explosé de 5 025% entre 2015 et 2023, passant de 4 millions à 205 millions de dollars — là encore, une responsabilité fédérale constitutionnelle.
Le contraste est frappant: les dépenses d’assurance-emploi — une compétence clairement fédérale — ont diminué de 3% durant la même période, et les dépenses de défense civile n’ont augmenté que de 29%.
Une dette qui grimpe avec les dépenses
L’étude établit un lien direct entre l’augmentation des dépenses fédérales et la hausse de l’endettement public. Les périodes d’expansion fédérale dans les juridictions provinciales ont historiquement été accompagnées d’une augmentation du ratio dette nette fédérale sur PIB. Entre 1914 et 1945, puis de 1970 au milieu des années 1990, et à nouveau après 2019 avec la pandémie, chaque montée des dépenses fédérales s’est traduite par une augmentation de la dette.
Cette dette représente une hypothèque sur les générations futures : ce sont les contribuables d’aujourd’hui et de demain qui devront la rembourser, avec intérêts. En 2023-2024, les frais de la dette publique fédérale ont atteint 47,3 milliards de dollars, une augmentation de 78% par rapport aux 26,6 milliards de 2014-2015.
Les leçons de l’histoire canadienne
Le passé offre des leçons claires, selon l’étude. Les trois grandes crises du 20e siècle — Première Guerre mondiale (1914-1918), Grande Dépression (années 1930), Seconde Guerre mondiale (1939-1945) — ont nécessité une concentration temporaire des pouvoirs à Ottawa. Mais ces centralisations étaient justifiées par des urgences nationales existentielles, pas par des ambitions politiques de créer des programmes sociaux pancanadiens en temps de paix.
L’étude rappelle que même les fondations de la Confédération reposaient sur un malentendu. George Brown, l’un des pères de la Confédération, envisageait initialement en 1864 une autorité conjointe minimale entre les colonies, mais les tensions de la guerre civile américaine ont poussé les négociateurs à créer un gouvernement central puissant en 1867.
Le premier ministre ontarien Oliver Mowat a ensuite passé des décennies, de 1872 à 1896, à reconquérir les pouvoirs provinciaux devant les tribunaux, forçant John A. Macdonald à le traiter de « jackal » et de « little tyrant ».
Les provinces aussi responsables
Les auteurs reconnaissent que les provinces ne sont pas exemptes de reproches. Elles acceptent volontiers l’argent fédéral assorti de conditions pour des programmes comme les garderies et l’assurance-médicaments, même si cela réduit leur autonomie.
Pendant la récente guerre tarifaire avec les États-Unis en 2025, le premier ministre ontarien Doug Ford a multiplié les apparitions à la télévision américaine et lancé une campagne publicitaire de 75 millions de dollars contre les tarifs douaniers. Bien que Ford agisse dans un domaine économique relevant de sa province, les chercheurs soulignent le paradoxe: en s’adressant directement aux Américains sur les chaînes nationales, il empiète sur les affaires étrangères, une compétence exclusivement fédérale. Les auteurs notent que les gouvernements étrangers risquent d’interpréter ces interventions médiatiques comme si un premier ministre provincial parlait au nom de tout le Canada, créant une confusion sur qui représente réellement le pays.
Le nouveau gouvernement Carney
L’étude a été publiée en octobre 2025 sous le nouveau gouvernement de Mark Carney, qui a remplacé Trudeau après sa démission forcée en décembre 2024. Les auteurs notent que le soutien au Bloc a chuté à 22 sièges lors de l’élection fédérale subséquente, suggérant que le départ de Trudeau et l’arrivée de Carney ont temporairement apaisé les tensions au moment de l’élection.
Carney annonce une augmentation importante des dépenses militaires, une compétence strictement fédérale, tout en tentant d’intervenir dans la crise du logement par des financements fédéraux. Les chercheurs se demandent si ces futurs projets dans les juridictions partagées seront menés dans la coopération ou la confrontation.
Recommandations pour l’avenir
Les conclusions de l’étude sont sans équivoque: la paix et la prospérité canadiennes sont mieux assurées lorsque chaque palier de gouvernement respecte ses champs de compétence constitutionnels. Le rapport recommande que tous les paliers de gouvernement consultent et négocient avant de lancer des initiatives majeures qui traversent les lignes de compétence.
Les auteurs insistent sur un minimum vital: les gouvernements ont l’obligation de se consulter mutuellement avant d’entreprendre des programmes de dépenses majeures, plutôt que d’opérer en vase clos. Cette coordination est essentielle pour éviter les conflits et la duplication des efforts.
L’étude met en garde: les intrusions fédérales futures dans la santé, l’éducation et les programmes sociaux seront probablement limitées à court terme compte tenu du climat international et du déplacement des priorités vers la défense. Mais la question cruciale demeure: les projets d’infrastructures proposés pour diversifier le commerce canadien seront-ils menés dans la coopération ou la confrontation?
Un message clair aux deux paliers
Le message du Fraser Institute est limpide : le fédéralisme canadien ne peut prospérer que si Ottawa et les provinces respectent leurs couloirs constitutionnels. Quand ils dévient de cette règle, c’est l’ensemble de la fédération qui paie le prix — politiquement par les tensions régionales, et financièrement par la facture que reçoivent les contribuables.
Pour les Québécois qui ont vécu les débats constitutionnels des dernières décennies, le constat est familier : le déséquilibre fiscal existe toujours, et Ottawa continue d’utiliser son pouvoir de dépenser pour s’ingérer dans des champs de compétence provinciale. La différence, c’est que maintenant les chiffres documentent précisément l’ampleur du problème.