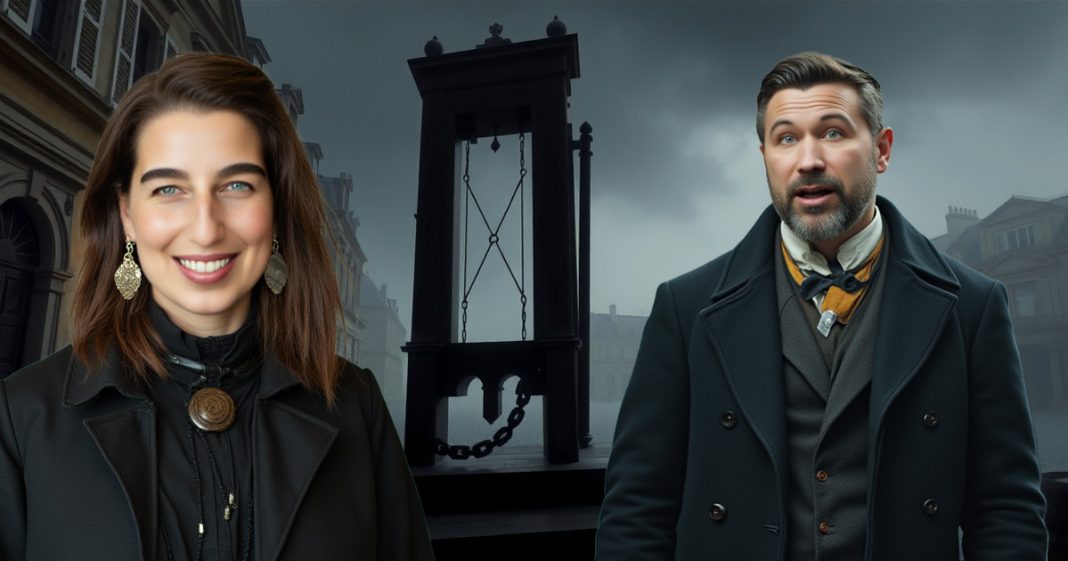Le budget de l’année fiscale 2025-2026 pour la province du Québec, intitulé « Vers un Québec prospère », se présente comme une feuille de route en faveur de l’innovation économique et sociale, tout en promouvant l’épanouissement de la société. Dans la continuité des orientations adoptées ces dernières années, ce plan financier prévoit d’importants investissements dans les infrastructures essentielles, ainsi que des aides financières ciblées pour des secteurs jugés prioritaires et diverses mesures de redistribution en faveur de groupes spécifiques. À première vue, difficile de contester de telles aspirations louables : qui refuserait une société plus prospère et plus équilibrée?
Cependant, une analyse plus approfondie révèle que ce budget maintient la tendance à l’intervention massive de l’État québécois, plutôt que de s’attaquer aux défauts du « modèle québécois » (taux d’imposition élevé, bureaucratie tentaculaire, endettement chronique). Il semble même aggraver ces travers. Nous examinerons donc en détail la teneur de ce budget et les réformes possibles pour que le Québec se libère, enfin, de son interventionnisme étatique traditionnel.
Nous présenterons d’abord les grandes orientations du document « Vers un Québec prospère » et soulignerons l’incohérence d’un projet se réclamant de l’innovation tout en encadrant étroitement l’initiative privée par des règles rigides. Nous aborderons ensuite les principaux griefs traditionnels exprimés par la pensée libérale : le poids de la fiscalité, l’ampleur de l’endettement public, la surdépendance aux subventions, ainsi que la préservation de monopoles d’État dans des secteurs-clés (santé, éducation, énergie). Une comparaison à l’échelle internationale (Suisse, Liechtenstein et certains États américains) démontrera qu’il est tout à fait possible d’allier prospérité et solidarité avec un État nettement plus modeste.
En conclusion, nous proposerons une série de mesures visant à réduire la taille de l’État, à décentraliser le pouvoir et à instaurer une concurrence réelle dans les domaines aujourd’hui sous monopole, afin de promouvoir une culture ancrée dans la liberté individuelle et la responsabilité. Nous espérons ainsi encourager un débat public approfondi quant à l’avenir économique du Québec, d’autant que la concurrence internationale se fait plus féroce et que la dette considérable accumulée risque, un jour, de peser lourdement sur les finances publiques et la qualité de vie de la population.
Contexte et objectifs du budget pour l’année fiscale 2025-2026
Un budget axé sur l’intervention gouvernementale
Sous la houlette du ministre Girard, le gouvernement propose « Pour un Québec fort », un plan global destiné à stimuler l’économie québécoise par la création et la modernisation de la richesse. Les documents budgétaires détaillent toute une gamme de mesures et d’orientations.
- Hausse des dépenses gouvernementales dans les infrastructures
– Le budget lié au Plan québécois des infrastructures (2025-2035) s’établit désormais à 164 milliards de dollars. – Cette augmentation s’explique par la volonté de « mettre en place des projets structurants », comme la construction de routes et d’installations médicales et éducatives. - Développement et consolidation de secteurs stratégiques
– Aides financières et avantages fiscaux en faveur de domaines comme les énergies renouvelables et durables, la technologie de pointe ou encore le développement régional.
– Le gouvernement met l’accent sur une transition vers des énergies plus propres pour lutter contre les changements climatiques, tout en modernisant les services publics. - Engagement pour l’égalité sociale
– Bonifications des mesures de soutien destinées aux familles et aux aînés à revenu modeste.
– Augmentation des budgets pour la formation professionnelle et l’employabilité. - Maintien d’une trajectoire de rééquilibrage budgétaire à long terme
– Le gouvernement promet de ramener l’équilibre budgétaire d’ici 2029-2030, après plusieurs années de déficits successifs et l’utilisation du Fonds des générations pour contrôler la dette.
Fort d’une ambition revendiquée de rendre le Québec plus prospère grâce à un État directeur, ce budget inscrit son action dans un courant politique solidement ancré depuis la Révolution tranquille. En effet, le Québec s’appuie depuis des décennies sur l’idée que l’État est légitime et capable d’organiser et de réglementer les multiples dimensions de la vie citoyenne. Du point de vue d’un observateur libéral dans son acception politique traditionnelle, cette posture idéologique soulève des interrogations quant aux conséquences potentiellement néfastes d’un État si présent. Nous reviendrons plus loin sur divers exemples montrant les effets potentiellement indésirables d’un tel interventionnisme, qui façonnent depuis longtemps l’environnement politique et social du Québec moderne.
Les fondements de l’analyse libérale traditionnelle
Un taux d’imposition déjà considérablement élevé
À chaque nouveau budget, le gouvernement du Québec réaffirme son recours à une pluralité d’instruments fiscaux : impôt sur le revenu (tant provincial que fédéral), taxes de vente (TPS et TVQ), diverses taxes sectorielles (taxe sur la masse salariale, taxe scolaire, taxe sur l’essence, redevances, etc.). Ainsi, le Québec figure parmi les régions nord-américaines où le fardeau fiscal est le plus lourd.
Or, d’après la perspective friedmanienne, imposer fortement le travail, le capital ou la consommation équivaut à pénaliser la productivité et l’initiative individuelle. En surtaxant ces composantes, on réduit les incitations à travailler davantage, à investir ou à consommer. Les investisseurs, qu’ils soient québécois ou étrangers, peuvent déployer leurs capitaux sur un marché mondial. Rien ne les contraint à demeurer dans un espace fiscal moins concurrentiel. Pourquoi, dès lors, le Québec conserve-t-il un système qui, en dépit de ses ambitions d’innovation et de prospérité, freine l’esprit d’entreprise?
Certes, le budget 2025-2026 propose quelques ajustements modestes — crédits d’impôt ciblés, aides ponctuelles pour certains secteurs —, mais il ne s’engage pas dans une réforme d’envergure. La pression fiscale globale continue d’augmenter, ce qui rend plus difficile la constitution d’un environnement compétitif à l’international.
Une dette publique en constante progression
Depuis de nombreuses années, le Québec traîne un important fardeau de dette publique, en pourcentage du PIB, supérieur à la moyenne canadienne. Les rapports budgétaires annoncent une stabilisation, suivie d’un léger recul, de la part de la dette dans le PIB à long terme (avec l’espoir de passer d’environ 40 % à 35 % d’ici 2032-2033, puis à 32 % vers 2037-2038). Dans les faits, toutefois, le budget 2025-2026 anticipe une succession de déficits jusqu’en 2029-2030 ; il faudra donc que la dette continue de croître avant d’amorcer un quelconque recul.
Sous l’angle keynésien, un endettement chronique compromet la prospérité à long terme : tout emprunt engage le remboursement d’intérêts qui pèsera sur les impôts des générations futures, pour financer des projets dont la rentabilité reste souvent incertaine. En outre, l’expérience internationale montre que les projets publics ne brillent pas toujours par leur rigueur : dépassements de coûts, retards, voire corruption… Les dépenses massives en infrastructures ne garantissent pas automatiquement un rendement proportionnel à l’ampleur des sommes investies.
Dans un contexte de concurrence accrue, un fort niveau d’endettement expose par ailleurs le Québec aux risques de hausses de taux d’intérêt et au jugement des agences de notation. Une remontée marquée des taux pourrait soudainement alourdir la facture du service de la dette, forçant le gouvernement à adopter des mesures d’austérité sévères ou à imposer davantage, au risque de précipiter l’économie dans la récession.
Subventions et crédits d’impôt : entre distorsions et « capitalisme de connivence »
L’une des caractéristiques du modèle québécois tient à l’abondance de subventions et de crédits d’impôt accordés à des secteurs jugés « stratégiques ». Dans le budget 2025-2026, des montants considérables sont ainsi dédiés au développement de l’intelligence artificielle, à la transformation numérique, à l’électrification des transports, à la filière batterie, mais aussi à des soutiens d’ordre social (subventions régionales, appui aux familles, etc.).
Du point de vue libéral classique, ces politiques interventionnistes soulèvent plusieurs enjeux :
- Distorsion concurrentielle
Les entreprises qui réussissent à obtenir des subventions (généralement définies par des comités gouvernementaux) profitent d’un avantage artificiel. En revanche, les PME qui ne répondent pas aux critères subventionnaires sont défavorisées et risquent même de disparaître si elles ne peuvent pas rivaliser avec des concurrents subventionnés. - Recherche de rente et clientélisme
Au lieu de consacrer leurs efforts à l’innovation ou à la satisfaction de la demande, certains acteurs passeront plus de temps à courtiser les gouvernements en vue d’obtenir des aides. La proximité politique prime alors sur la performance économique réelle. - Gaspillage et aléa moral
Les projets soutenus par l’argent public échappent davantage aux exigences de rentabilité, sachant qu’en cas d’échec, la facture retombe sur les contribuables. Cette situation favorise la prise de risques excessifs et affaiblit la discipline de marché, normalement garante d’une innovation efficace.
La domination persistante du secteur public dans la santé, l’éducation et l’énergie
Malgré les discours officiels sur l’innovation et la modernisation, le budget actuel ne propose aucune réforme d’envergure pour introduire davantage de concurrence dans les secteurs largement étatisés, comme la santé et l’éducation, toujours sous le régime du monopole public (ou quasi-monopole). Hydro-Québec, considérée comme un fleuron national, demeure sous contrôle exclusif de l’État ; il n’est pas fait mention de son éventuelle privatisation partielle ni d’une libéralisation du marché électrique.
Pourtant, de nombreux pays ont déjà instauré avec succès des systèmes hybrides dans la santé et l’éducation, associant un socle public universel et une couverture privée concurrentielle, ce qui réduit les temps d’attente et favorise la qualité de service, tout en offrant une plus grande flexibilité de gestion. De même, la déréglementation partielle du secteur de l’énergie a démontré, dans plusieurs régions du monde, la possibilité de mieux répondre à la demande réelle et de dynamiser l’innovation (petites centrales, solutions locales décentralisées, etc.).
Modèles économiques plus légers : quelques références internationales
Pour souligner que la prospérité ne requiert pas nécessairement un État hypertrophié, nous examinons brièvement la Suisse, le Liechtenstein et certains États américains, qui montrent à quel point la liberté individuelle, la responsabilité et la compétitivité peuvent être encouragées par un cadre étatique plus restreint.
La Suisse : décentralisation et participation directe
- Forte décentralisation
Les cantons se disputent investisseurs et travailleurs via des ajustements fiscaux et réglementaires. - Démocratie directe
Les grands projets de dépense ou de hausses d’impôt peuvent être soumis à référendum, obligeant les autorités à une gestion plus prudente. - Système de santé mixte
Plusieurs assureurs privés sont en concurrence, sous un encadrement qui garantit à tous un accès minimal.
La Suisse maintient un niveau de vie très élevé, un faible taux de chômage et une dette publique soutenable. Son adaptabilité face aux crises financières découle d’un modèle plus flexible, valorisant la discipline budgétaire.
Le Liechtenstein : un micro-État résolument performant
Souvent assimilé à un « paradis fiscal », ce petit pays bénéficie d’un revenu par habitant parmi les plus élevés au monde. Il tire sa force de :
- Taux d’imposition simple et modéré
- Garanties solides des droits de propriété
- État minimaliste, où l’entrepreneuriat est libre de s’épanouir
Malgré son exiguïté, le Liechtenstein accueille un secteur financier et industriel de pointe, notamment dans les hautes technologies. Le contexte historique et politique y est particulier, mais on y observe qu’un territoire de taille réduite peut miser sur la sobriété étatique et la compétitivité fiscale pour prospérer.
Certains États américains : concurrence et souplesse
Aux États-Unis, chaque État jouit d’une grande autonomie en matière de politique budgétaire et fiscale. On remarque, par exemple, que le Texas et la Floride, grâce à une faible taxation (voire nulle pour l’impôt sur le revenu des particuliers), attirent des vagues d’entreprises et de travailleurs qualifiés, dopant ainsi croissance et emploi. Ce fédéralisme favorise l’expérimentation simultanée de politiques publiques. L’absence totale d’impôt sur le revenu dans certains États américains rend le Québec moins attrayant pour les investisseurs internationaux et les travailleurs hautement qualifiés, vu son fardeau fiscal plus élevé.
Pourquoi le Québec persiste-t-il dans un modèle interventionniste?
Héritage historique de la Révolution tranquille
Depuis les années 1960, le Québec a développé un État-providence étendu pour combler ce qui était perçu comme un retard économique et social. La nationalisation de la santé, de l’éducation et de l’énergie, combinée à de nombreux programmes sociaux, a profondément ancré l’idée que l’État constitue la locomotive du progrès. Bien que certains indicateurs — salaires en deçà de la moyenne canadienne, exode des diplômés, lourde bureaucratie — montrent une réalité moins reluisante, le consensus en faveur d’un interventionnisme généralisé demeure très puissant.
L’influence des groupes d’intérêt et de la bureaucratie
Les acteurs du secteur public (syndicats et fonctionnaires de divers organismes subventionnés) exercent une pression constante pour préserver, voire accroître, les budgets en place. Toute volonté de réduire la taille du gouvernement suscite alors une vive opposition de la part de ces groupes bien organisés, craignant la suppression d’emplois ou la perte de privilèges. Par ailleurs, la bureaucratie tend à se reproduire : chaque nouveau programme s’accompagne d’une augmentation du personnel et de structures administratives supplémentaires, ce qui accroît l’inertie du système.
Populisme économique et résistance au changement
Lors des campagnes électorales, il est bien plus aisé de promettre de nouveaux services et des subventions additionnelles que de proposer un plan visant à réduire la fiscalité et la dette publique. Les responsables politiques rechignent à remettre en cause la croyance populaire voulant que « plus d’État = plus de sécurité », sans parler du tabou consistant à diminuer les budgets de la santé ou de l’éducation. Cette dynamique alimente l’idée qu’un État plus restreint conduirait inévitablement à une société déshumanisée, négligeant les personnes les plus vulnérables.
Les risques à moyen et long terme d’un tel budget
Stagnation économique et maintien des écarts de richesse
La conjugaison d’une pression fiscale élevée et d’une bureaucratie lourde, à long terme, risque de freiner la croissance économique du Québec. Les comparaisons nationales et internationales soulignent l’importance, pour le secteur privé, de disposer de la souplesse nécessaire pour s’adapter aux signaux du marché et créer de la richesse à long terme. Lorsque l’État domine trop l’économie et bride l’initiative des entreprises dans un contexte concurrentiel dynamique, la prospérité s’en trouve entravée.
Risques d’exode des talents et des capitaux
La mondialisation facilite grandement la mobilité des travailleurs et des flux financiers. Les professionnels hautement qualifiés peuvent être incités à quitter le Québec pour des régions offrant de meilleures perspectives de revenu et d’évolution professionnelle, dans un cadre administratif plus léger. De même, les investisseurs institutionnels s’orientent spontanément vers des endroits où la pression fiscale est moins dissuasive. Si ce phénomène se prolonge, il érode progressivement l’élan économique et la capacité d’innover.
Vulnérabilité financière en cas de hausse des taux d’intérêt
Une remontée brutale des taux d’intérêt pourrait alourdir la charge de la dette d’un État déjà très endetté. Les agences de notation demanderaient alors des primes de risque plus élevées, alimentant un cercle vicieux : plus la dette coûte cher à financer, plus le gouvernement serait amené à augmenter les impôts ou à réduire ses dépenses. Les coupes devraient alors être réalisées à la hâte, avec des effets potentiellement douloureux pour les services publics et l’ensemble de l’économie.
Pour un État minimaliste et transparent : pistes de réforme
Face au constat que le système actuel ne résout pas les problèmes structurels du Québec, plusieurs réformes ambitieuses s’inspirant de la pensée libérale traditionnelle pourraient être envisagées.
1. Réduction marquée de l’impôt sur le revenu
Pour encourager la compétitivité économique et stimuler l’activité, il serait pertinent de réduire significativement l’impôt sur le revenu, tout en simplifiant la structure des taux. De telles baisses auraient pour effet d’accroître l’investissement et la production, ce qui pourrait finalement augmenter les recettes fiscales de l’État ; un paradoxe apparent, mais observé à de multiples reprises lorsqu’un climat fiscal plus sain est instauré.
2. Privatisation et concurrence dans la santé et l’éducation
Plutôt que d’augmenter systématiquement les budgets de la santé et de l’éducation, on pourrait envisager d’ouvrir ces secteurs à la concurrence, dans un cadre réglementaire assurant l’accès universel aux soins et aux services de base. Par exemple :
- Cliniques et hôpitaux privés rémunérés à l’acte, où la concurrence inciterait à améliorer l’efficacité et à réduire les temps d’attente.
- Vouchers scolaires, permettant aux parents de choisir librement l’établissement de leurs enfants ; écoles publiques et privées s’efforceraient alors d’innover pour attirer et satisfaire leurs élèves.
Certes, une évolution culturelle en profondeur s’avère nécessaire, mais certains pays (Suède, Pays-Bas) ont déjà partiellement adopté de tels systèmes (écoles indépendantes, assureurs santé privés).
3. Abolition des subventions ciblées et diminution des avantages fiscaux
Au lieu de multiplier les subventions aux secteurs décrétés « prioritaires », l’État gagnerait à promouvoir un environnement d’affaires neutre, caractérisé par une fiscalité raisonnable, des règles simples et un respect de la liberté contractuelle. L’expérience montre en effet que c’est souvent un cadre stable et transparent (plutôt qu’un empilement de programmes d’aides) qui favorise l’innovation et l’efficacité.
4. Privatisation ou ouverture partielle d’Hydro-Québec
Hydro-Québec est longtemps restée un symbole national depuis la nationalisation de l’électricité. Toutefois, le développement rapide de nouvelles technologies (énergie solaire, microcentrales, réseaux intelligents) suggère que le monopole public risque de ralentir l’innovation et de brider la compétitivité. Une ouverture graduelle de son capital — via une participation privée minoritaire ou une déréglementation partielle — pourrait dégager des fonds pour rembourser une partie de la dette et dynamiser le marché de l’électricité. Les Québécois conserveraient potentiellement un contrôle majoritaire, tout en bénéficiant de l’émulation qu’offre la concurrence.
5. Encadrement strict de la dette et référendums pour les grands projets
Pour éviter la répétition de cycles d’endettement, le Québec pourrait instituer :
- Une loi-cadre limitant la croissance des dépenses à un rythme inférieur à celui de l’économie.
- Un référendum obligatoire pour tout projet public dont l’ampleur financière dépasse un seuil établi ou pour toute hausse majeure de la fiscalité, s’inspirant ainsi du modèle de démocratie directe suisse.
Une telle mesure contraindrait la classe politique à prioriser judicieusement les investissements et à éviter le lancement de projets inutiles ou mal ciblés.
Arguments courants et réponses aux objections
Toute proposition de restreindre le rôle de l’État soulève diverses objections. Voici quelques exemples et des éclairages issus de la pensée libérale classique :
- « Réduire les dépenses d’État nuit aux plus vulnérables. »
En réalité, la solidarité peut s’exprimer hors du cadre bureaucratique (associations, fondations privées, etc.). De plus, un contexte de forte croissance, stimulé par la liberté d’entreprendre, engendre davantage d’emplois et de ressources, que la collectivité peut ensuite rediriger vers des programmes sociaux mieux ciblés et plus efficaces. - « Des sociétés d’État comme Hydro-Québec protègent nos ressources naturelles. »
Il n’est pas nécessaire de « brader » ces ressources dans le cadre d’une privatisation partielle ou d’une mise en concurrence : des mécanismes peuvent assurer la préservation du patrimoine naturel tout en améliorant l’efficience de la production d’électricité. - « Sans subventions, nos secteurs stratégiques s’effondreront. »
Les entreprises véritablement compétitives trouvent en général des capitaux privés. Miser sur des subventions publiques massives peut encourager la dépendance et le gaspillage. - « Une privatisation accrue dans la santé ou l’éducation creusera les inégalités. »
Plusieurs pays démontrent qu’on peut simultanément garantir un accès universel de base (financé par la collectivité) et permettre des initiatives privées, ce qui favorise l’innovation et la qualité du service.
Regard sur le document « Renforcer le Québec » (Budget 2025-2026)
Dans ses quelque 200 pages, le plan budgétaire 2025-2026 illustre la continuité d’une vision étatique bien ancrée, visant à identifier des priorités « stratégiques », à y injecter des sommes considérables et à créer des organismes publics chargés de superviser ces actions. Bien qu’il mette en avant la transition énergétique, l’appui aux familles, l’innovation numérique ou encore le développement de secteurs « verts », on remarque plusieurs points :
- Montants colossaux investis
Les investissements publics de plus de 11 milliards de dollars s’ajoutent à un PQI déjà considérable, couvrant la santé, l’éducation et le transport. Aucune mesure spécifique ne vient circonscrire le risque de dépassement de coûts. - Multiplication de subventions et crédits d’impôt
Les dispositifs fiscaux au service de l’innovation demeurent complexes (CRIC, exemptions sectorielles, etc.). Malgré des intentions de « simplification », on se retrouve avec une accumulation de mesures ponctuelles. - Retour à l’équilibre… dans quelques années
Le déficit pour 2025-2026 devrait s’élever à environ 11 milliards de dollars, après un solde négatif de 8,1 milliards pour 2024-2025. Un maigre surplus de 0,4 milliard n’est attendu qu’en 2029-2030, sous réserve d’un contexte macroéconomique favorable. - Fonds des générations toujours insuffisant
Les montants versés au Fonds des générations ne couvrent qu’une fraction de la dette, et si l’engagement à l’alimenter reste symboliquement maintenu, il ne permet pas de véritable allègement à court terme.
Au final, le document témoigne d’une nette préférence pour la planification publique et la redistribution, plutôt que pour la libre concurrence et l’initiative individuelle.
Le budget 2025-2026, intitulé « Pour un Québec fort », reflète la continuité du modèle québécois traditionnel : un fort interventionnisme de l’État et une fiscalité élevée, conduisant à un endettement prolongé, à la multiplication de subventions et à la persistance de monopoles publics. Bien que les intentions affichées soient de stimuler la croissance économique, de soutenir les plus démunis et de favoriser la transition énergétique, les résultats risquent de ne pas répondre à toutes les attentes. L’histoire récente et les comparaisons internationales montrent que la prospérité ne se décrète pas par la dépense publique ou le centralisme, mais naît plutôt de la liberté d’entreprendre et d’une saine concurrence dans un cadre fiscal adéquat.
Friedrich Hayek, Ludwig von Mises et Milton Friedman l’ont souvent rappelé : un gouvernement qui intervient à outrance fausse les signaux du marché et incite les agents économiques à privilégier des stratégies de lobbying politique plutôt qu’à innover ou à satisfaire la demande réelle. Un État qui se veut le grand planificateur ne peut rivaliser avec la flexibilité et l’adaptabilité de l’entrepreneuriat privé, capable de répondre aux besoins du moment.
Le Québec se trouve dans une situation où la dette est déjà considérable, où la bureaucratie pèse lourdement et où la pression fiscale reste élevée, ce qui pourrait s’aggraver à moyen terme. Le départ de main-d’œuvre qualifiée, la difficulté à réagir aux crises internationales et la diminution de l’investissement privé figurent parmi les scénarios redoutés. Pour éviter cet écueil, un changement radical s’impose. Il ne s’agit pas de faire table rase de toute solidarité : l’État doit rester garant des fonctions régaliennes et maintenir un filet social minimal. Toutefois, l’enjeu demeure de recentrer le rôle de l’État (justice, sécurité, diplomatie économique, protections fondamentales) tout en permettant aux individus d’exercer leurs libertés dans la plupart des domaines.
Propositions pour un virage libérateur
- Abaisser substantiellement l’impôt sur le revenu
Afin de stimuler l’activité économique et l’investissement. - Introduire la concurrence dans la santé et l’éducation
Par l’instauration de cliniques privées et de programmes de vouchers scolaires. - Mettre fin aux subventions ciblées
Au profit d’un cadre fiscal plus simple, équitable et propice à l’émulation concurrentielle. - Moderniser Hydro-Québec
Via une déréglementation ou une privatisation partielle, pour renforcer le dynamisme du marché de l’énergie et réduire le fardeau financier public. - Encadrer strictement la dette
En instaurant des règles claires et, idéalement, des référendums populaires pour tout projet d’infrastructures majeur ou toute hausse d’impôts.
Loin d’être un programme antisocial, une telle démarche favorise un entrepreneuriat foisonnant, générateur de richesses plus abondantes et mieux réparties. Dans un système concurrentiel, les fournisseurs de services (hôpitaux, établissements scolaires, compagnies énergétiques) sont incités à améliorer la qualité tout en contrôlant leurs coûts, au bénéfice de tous.
Un Québec riche de talents et de ressources
Le Québec dispose déjà de multiples atouts : un vivier de compétences variées, des ressources naturelles précieuses et une identité culturelle forte. Mais ce budget 2025-2026 risque de prolonger son cycle d’endettement et sa dépendance à l’égard d’un État omniprésent. Au lieu de reconduire ce réflexe interventionniste, nous gagnerions à puiser dans la tradition libérale, qui peut véritablement faire éclore un renouveau national. Parfois, le recul de l’État n’est pas un désengagement, mais un signe de confiance dans la créativité d’individus libres et responsables, agissant dans un cadre légal clair. Autant de forces qu’aucune structure centralisée ne saurait pleinement « planifier » par décret.
Le ministre Girard peut bien affirmer qu’il cherche à « renforcer » le Québec, mais la véritable force d’une société ne se mesure ni à la taille de son gouvernement ni à l’ampleur de ses subventions. Elle se reflète plutôt dans la vitalité de ses entrepreneurs, dans le degré d’autonomie de ses citoyens et dans la qualité des services librement offerts. Elle se constate également dans la capacité à absorber les chocs de l’économie mondiale. Sur ce point, le Québec gagnerait à rompre avec certains réflexes paternalistes et à laisser s’épanouir les énergies créatives dormantes.
Épilogue : un horizon de liberté
Comme le disait Milton Friedman, « c’est une grave erreur d’évaluer les politiques et programmes d’après leurs intentions plutôt que leurs résultats ». Il est vain d’accumuler des lignes budgétaires et des comités d’experts tant qu’on ne touche pas au fondamental : un fardeau fiscal lourd et de vastes monopoles publics. Les conséquences sont toujours les mêmes : une croissance modeste, doublée d’une dépendance envers l’État.
Pour sortir de l’ornière, il faut cesser de croire que le gouvernement sait mieux allouer les ressources que des acteurs libres sur un marché concurrentiel. Bien sûr, l’État conserve la charge de l’équité en droit, de la sécurité et d’un socle de solidarité élémentaire. Mais au-delà, son intervention aboutit souvent à des inefficiences qui brident l’initiative privée.
Ce budget prétend introduire une vision neuve, mais ne s’attaque pas aux fondements dont découle l’interventionnisme québécois actuel. La responsabilité nous revient, à nous, citoyens engagés, de prolonger la réflexion et de remettre en cause ce modèle historique. Le choix est clair : laisser la liberté, la compétitivité et la prospérité s’éroder, ou reconnaître que l’hypertrophie de l’État nous bloque dans une impasse.
La tradition libérale propose une voie cohérente, soutenue par des exemples tangibles autour du globe. Tandis que la concurrence mondiale s’intensifie et que les tensions commerciales s’exacerbent, le Québec devra tôt ou tard franchir un pas décisif : rester prisonnier de ses réflexes interventionnistes, ou admettre que la sobriété étatique, alliée à une discipline budgétaire réelle, constitue un terreau fertile où germe l’innovation. À nous d’ouvrir cette voie et de léguer aux générations futures un Québec véritablement « fort », porté par une relance économique durable et une liberté renouvelée.