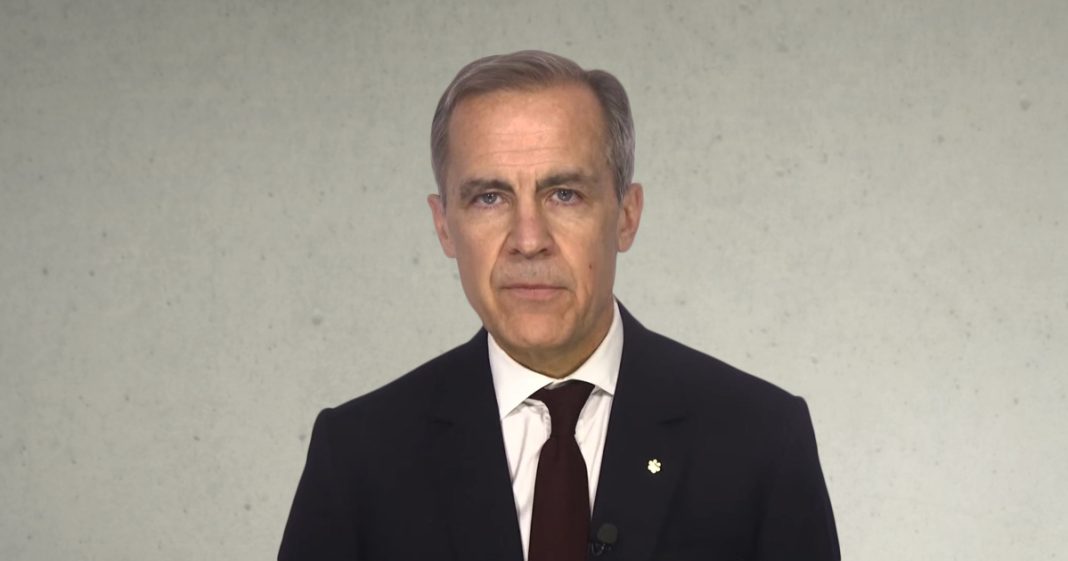Le 17 juillet 2025 restera marqué dans les annales comme une journée où les bonnes intentions gouvernementales ont rencontré la frustration accumulée de 150 ans d’histoire. Le sommet sur les projets majeurs organisé par Ottawa avec les chefs des Premières Nations a révélé un fossé béant entre les promesses de réconciliation et les attentes concrètes des communautés autochtones.
Un dialogue qui commence mal
Le ton était donné dès l’ouverture. « Aujourd’hui, ce n’était pas une consultation. Aujourd’hui, ce n’était simplement qu’un engagement, tout comme hier. », a lancé la chef Angela Levasseur de la nation crie Nisichayasik.
« Aujourd’hui, il ne s’agissait pas de consultation. Aujourd’hui devait être la première de plusieurs rencontres », a déclaré Kyra Wilson, grande cheffe de l’Assemblée des chefs du Manitoba. Cette précision, loin d’être anodine, illustre parfaitement la complexité bureaucratique qui caractérise désormais les relations entre Ottawa et les Premières Nations.
Le projet de loi C-5, adopté en vitesse sans consultation préalable, cristallise les tensions. Brian Hardlotte du Prince Albert Grand Council n’y va pas par quatre chemins : « Je n’appellerais pas vraiment ça une consultation. Vous savez, la consultation a lieu avant quoi que ce soit — un projet, ou même, dans ce cas, une loi ».
La chef Levasseur a choisi une image marquante : « Historiquement, le Canada et les Premières Nations ont été engagés dans une relation abusive. Un peu comme dans les relations conjugales violentes, les choses se passaient bien au début ». Cette métaphore percutante illustre parfaitement le climat de méfiance qui planait sur les discussions.
La question de la possession : entre revendications et réalité juridique
Marcel Head affirme catégoriquement que « nous n’avons jamais cédé notre terre, nous n’avons jamais cédé nos ressources quand nous avons signé le traité ». Cette position reflète l’interprétation autochtone des traités comme des accords de partage plutôt que de cession. Cependant, cette vision se heurte à plus d’un siècle de jurisprudence et de développement économique basés sur une interprétation différente.
Le chef Fabian Head de la Federation of Sovereign Indigenous Nations renforce cette position : « Les Premières Nations n’ont pas cédé, abandonné ou renoncé à leurs droits sur les terres et les ressources. Nous avons accepté de partager la terre, mais nous n’avons rien donné en ce qui concerne les droits sur les ressources dont nous dépendions ». Cette affirmation constitue le fondement juridique de leurs revendications actuelles.
Des garanties monétaires qui tardent à se concrétiser
Sur le plan économique, les attentes sont considérables, mais les garanties restent floues. Le gouvernement a annoncé une augmentation du programme de garanties de prêts autochtones de 5 à 10 milliards de dollars, ainsi que 40 millions pour le développement des capacités.
Cependant, les chefs restent sceptiques. Jacko souligne une réalité qui dérange : « On ne reçoit pas d’argent provenant des redevances et des sables bitumineux ».
Marcel Head de Shoal Lake Cree Nation propose une formule de partage tripartite des profits : « Si ce projet s’avère rentable, ce qu’on mettra dans une entente, dans un plan d’affaires — la manière dont on répartira les profits qui en découleront — sera partagé également entre toutes les entités ». Sa vision divise les bénéfices en trois parts égales entre les Premières Nations, l’industrie et les gouvernements. Cette formule soulève des questions sur l’équité du partage des risques, puisque les profits sont répartis également même si l’exposition financière diffère substantiellement entre les parties.
Des partenaires économiques stratégiques ou des gardiens territoriaux ?
La position des Premières Nations dans l’économie canadienne révèle une réalité complexe que les ministres peinent à définir clairement. Lorsqu’on demande à la ministre Rebecca Alty si l’unanimité sera nécessaire pour les projets, sa réponse évite soigneusement l’engagement : « Nous cherchons les projets qui ont de fortes chances de réussir ».
Cette approche sélective suggère que le gouvernement considère les Premières Nations moins comme des partenaires que comme des détenteurs de droits de véto qu’il faut amadouer. La ministre Mandy Gull-Masty le confirme involontairement : « La probabilité que ces projets avancent ou se réalisent sans les Autochtones à la table… pour moi, c’était pratiquement zéro ».
Cette reconnaissance ne témoigne pas d’un partenariat économique, mais plutôt de la réalité juridique contemporaine où les Premières Nations peuvent bloquer les grands projets. Comme l’observe Chief Kelsey Jacko avec frustration : « Quand on parle de nation à nation, aucune organisation ne parle en mon nom », illustrant la fragmentation qui complique toute approche de partenariat uniforme.
Marcel Head tente de transformer cette contrainte en opportunité avec sa formule tripartite, mais sa déclaration « On va gagner. Tout le monde va gagner » ressemble davantage à une stratégie de contournement qu’à un véritable partenariat entrepreneurial.
La séquestration du carbone : l’équation économique douteuse
Le projet Pathways de séquestration du carbone, d’une envergure comparable au Nouveau-Brunswick, cristallise les tensions entre ambitions environnementales et réalités économiques. Le chef Kelsey Jacko de Coal Lake First Nation formule une critique qui résonne au-delà des considérations écologiques : « C’est une science non éprouvée, et il n’y a pas d’argent derrière ».
Cette observation soulève des questions fondamentales sur l’allocation des ressources publiques. Contrairement aux projets d’extraction traditionnels qui génèrent des revenus immédiats, la séquestration du carbone représente un investissement à fonds perdu sans garantie de retour économique mesurable. Jacko le souligne avec pragmatisme : « Eh bien, c’est un peu difficile, parce que cette séquestration du carbone, il n’y a pas d’argent en jeu. Il n’y a pas de participation, n’est-ce pas? Sauf si on fait partie de ceux qui imposent et contrôlent les crédits carbone ou quoi que ce soit ».
L’absence de mécanisme de financement clair pour ce type de projet révèle une incohérence dans la politique économique gouvernementale. Selon Jack, pendant que l’Alberta génère « 72 milliards » de dollars en revenus pétroliers, le gouvernement fédéral propose d’investir dans des technologies non éprouvées sans perspective de rentabilité mesurable.
Les préoccupations opérationnelles soulevées par Jacko démontrent les lacunes dans la planification gouvernementale : « Ils n’ont même pas de plan d’intervention d’urgence. Ils dépendent uniquement de la Terre Mère ». Cette improvisation contraste avec les standards industriels habituels où la gestion des risques constitue un prérequis.
L’histoire des grands projets gouvernementaux au Canada offre des leçons instructives. Chief Angela Angela Levasseur rappelle que le détournement de la rivière Churchill par Manitoba Hydro a « a submergé la communauté de South Indian Lake sous dix pieds d’eau », transformant une communauté autosuffisante en dépendante des transferts gouvernementaux. Elle observe : « Nous n’avions jamais eu besoin de ça, et ce sont les projets d’intérêt national comme les barrages hydroélectriques, les pipelines et les mines qui nous ont menés à ce point où nous devons dépendre du gouvernement pour survivre ».
Ces précédents illustrent comment les projets d’envergure nationale, malgré leurs intentions louables, peuvent générer des coûts sociaux à long terme. La mine de Rutan à Leaf Rapids constitue un autre exemple : après des décennies d’exploitation, « la ville entière est évacuée en ce moment » et la communauté vit sous un « avis d’ébullition de l’eau depuis plus de 20 ans ».
Ces cas témoignent aussi des limites d’une planification centralisée où les décisions étaient souvent prises à distance, sans réelle évaluation des conséquences locales. Ils rappellent les échecs conjoints de gouvernements et d’entreprises, dans une époque où ni la gouvernance environnementale ni la reddition de comptes n’étaient à la hauteur. Depuis, plusieurs programmes d’indemnisation ou de compensation ont été mis en place, bien que souvent jugés insuffisants par les communautés concernées.
Jacko soulève également une préoccupation technique cruciale concernant la durabilité de la séquestration : « Les projets Pathways ne peuvent pas être dans l’intérêt national à moins qu’ils puissent prouver que le carbone restera dans le sol pendant mille ans ». Cette exigence met en lumière l’incertitude technologique qui entoure ces investissements massifs alors que le projet Pathways vise à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier canadien en capturant le dioxyde de carbone (CO₂) à la source, puis en le transportant et en le stockant de manière permanente sous terre.
Vers une nouvelle ère de partenariats ?
Malgré les tensions, des signes encourageants émergent. Le premier ministre a promis des visites sur les territoires, notamment celui de Jacko. Ces engagements directs pourraient marquer un tournant dans les relations nation-à-nation.
Le vice-chef Fabian Head de la Federation of Sovereign Indigenous Nations résume bien l’enjeu : « Les Premières Nations veulent contribuer à bâtir le Canada et l’économie canadienne à l’échelle mondiale, mais nous ne le ferons pas au détriment de nos droits sur les terres et les eaux ».
Conclusion : L’heure des choix stratégiques
Ce sommet révèle une réalité incontournable : les Premières Nations ne sont plus des spectateurs passifs du développement économique canadien. Elles sont devenues des acteurs économiques incontournables dont le consentement et la participation conditionnent le succès des grands projets nationaux.
L’approche pragmatique d’Ottawa, privilégiant les projets consensuels, témoigne d’une adaptation nécessaire aux nouvelles réalités politiques et économiques. Reste à voir si cette évolution suffira à combler le fossé creusé par 150 ans de promesses non tenues.
Comme le souligne judicieusement Head : « On ne peut pas continuer à réagir à des lois qui n’ont jamais été faites pour nous. Nous devons bâtir nos propres systèmes ». Cette quête d’autonomie pourrait bien redéfinir l’équilibre des forces dans le Canada de demain — à condition qu’elle s’oriente vers des modèles locaux plus efficaces, fondés sur l’initiative entrepreneuriale, la gestion autonome des revenus et une réduction de la dépendance aux transferts fédéraux. Une autonomie qui ne signifie pas l’isolement, mais plutôt la capacité d’agir avec des leviers concrets sur leur propre développement.