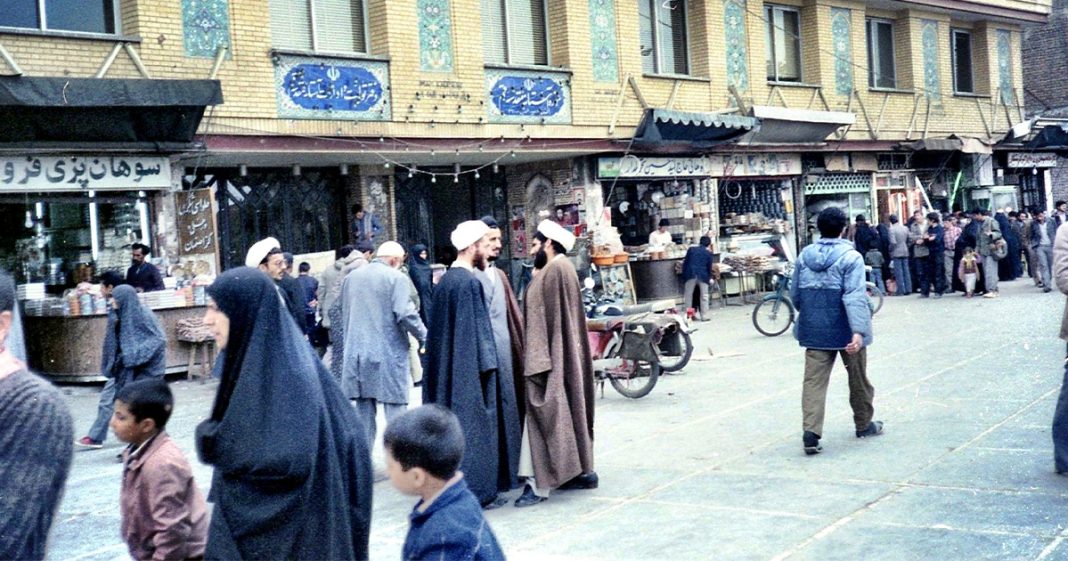Une nouvelle étude de l’Institut Fraser vient de lever le voile sur une réalité qui risque de choquer bien des contribuables canadiens : les familles moyennes consacrent désormais 42,3% de leurs revenus aux taxes et impôts, contre seulement 35,5% pour leurs besoins de base comme le logement, la nourriture et les vêtements.
Les chiffres, compilés dans l’édition 2025 de l’Index canadien de consommation fiscale, dressent un portrait saisissant de l’évolution du fardeau fiscal au pays. En 1961, la situation était inverse : les familles consacraient 56,5% de leurs revenus aux nécessités de base et 33,5% aux taxes.
Une montée fulgurante du fardeau fiscal
L’ampleur de la hausse du fardeau fiscal fait froid dans le dos. La facture fiscale totale des familles canadiennes a bondi de 2 784% depuis 1961, passant de 1 675$ à 48 306$ en 2024. Pour mettre cette hausse en perspective, les dépenses en logement ont augmenté de 2 129%, celles en nourriture de 927% et celles en vêtements de seulement 460% sur la même période.
« The 2,784% increase in the tax bill has also greatly outpaced the increase in the Consumer Price Index (925%) », souligne l’étude. Cette croissance astronomique dépasse même l’augmentation générale des prix à la consommation, révélant que les taxes ont progressé bien au-delà de l’inflation normale, et plus encore que la hausse du logement.
La famille canadienne moyenne gagnait 114 289$ en 2024 et payait 48 306$ en taxes diverses, soit 42,3% de ses revenus. À titre de comparaison, en 1961, une famille moyenne gagnait 5 000 $ et versait 1 675 $ en taxes, soit 33,5 % de ses revenus.
Un cocktail fiscal particulièrement corsé
L’étude détaille minutieusement la composition de cette facture fiscale. Les impôts sur le revenu représentent la plus grosse part avec 31,2% du total, suivis par les taxes sur la masse salariale et de santé (21,4%) et les taxes de vente (14,1%).
Les familles paient également des taxes foncières (8,5%), des taxes sur les profits (13,5%), sans oublier une panoplie d’autres prélèvements : taxes sur l’alcool et le tabac, taxes sur les carburants, taxes sur les véhicules, taxes sur les ressources naturelles, droits de douane. Un véritable buffet à volonté pour les gouvernements.
Le croisement historique de 1981
L’année 1981 marque un tournant symbolique dans l’histoire fiscale canadienne. C’est à ce moment précis que les courbes se sont croisées : les taxes représentaient alors 40,8% des revenus familiaux, tandis que les dépenses pour les nécessités de base comptaient pour 40,5%.
Depuis cette date charnière, l’écart n’a cessé de se creuser en faveur du fisc. « By comparison, 33.5% of the average family’s income went to pay taxes in 1961 while 56.5% went to basic necessities », rappelle l’étude, illustrant l’ampleur du renversement.
Le spectre des déficits : une taxation différée
L’Institut Fraser va plus loin dans son analyse en calculant ce qu’il appelle l’Index fiscal du budget équilibré. Si les gouvernements devaient équilibrer leurs budgets en augmentant les taxes plutôt qu’en s’endettant, la facture fiscale grimperait à 2 969% depuis 1961 (comparativement à 2 784%).
Cette approche révèle une réalité dérangeante : les déficits actuels ne font que reporter la facture fiscale à plus tard. « Deficits should therefore be considered as deferred taxation », prévient l’étude. Une épée de Damoclès qui plane au-dessus des contribuables futurs.
Ce sont donc les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qui hériteront d’une facture pour des dépenses dont ils ne profiteront peut-être jamais.
L’inflation : un faux-fuyant
Même en tenant compte de l’inflation, la pilule reste amère. L’Index fiscal ajusté pour l’inflation affiche tout de même une hausse de 181,4% depuis 1961. Les taxes ont donc bel et bien progressé plus rapidement que le pouvoir d’achat des familles.
Cette donnée pulvérise l’argument selon lequel la hausse des taxes ne serait qu’un effet de l’érosion monétaire. Les contribuables canadiens paient proportionnellement beaucoup plus qu’avant, point final.
Un portrait qui fait réfléchir
L’étude révèle également que la composition des dépenses familiales s’est complètement métamorphosée. En 2024, une famille moyenne consacre 22% de ses revenus au logement, 11,3% à la nourriture et seulement 2,1% aux vêtements. Le reste de 22,2% va aux autres dépenses incluant les communications, les transports, les soins de santé et les loisirs.
Cette redistribution des priorités budgétaires illustre non seulement l’évolution des modes de vie, mais aussi la pression croissante exercée par la fiscalité sur les choix de consommation des familles.
Une méthodologie rigoureuse
L’Institut Fraser base ses calculs sur une méthodologie exhaustive qui inclut tous les types de taxes : impôts sur le revenu, taxes sur la masse salariale, taxes de santé, taxes de vente, taxes foncières, taxes sur les carburants, taxes sur le carbone, taxes sur les véhicules, droits de douane, taxes sur l’alcool et le tabac.
L’institut prend également en compte les taxes payées par les entreprises, considérant que ces coûts sont ultimement refilés aux consommateurs. « Although businesses pay these taxes directly, the cost of business taxation is ultimately passed onto ordinary Canadians », précise l’étude.
Un réveil brutal pour les contribuables
Ces données, aussi accablantes soient-elles, offrent un portrait sans fard de l’évolution du fardeau fiscal canadien. Elles révèlent comment les taxes sont devenues le poste budgétaire le plus important des familles, dépassant même leurs besoins fondamentaux de logement, de nourriture et de vêtements combinés.
L’étude de l’Institut Fraser, menée par Jake Fuss et Grady Munro, se base sur des données officielles de Statistique Canada et les calculs utilisés pour déterminer la Journée de liberté fiscale. Cette approche méthodique garantit la fiabilité des conclusions, aussi dérangeantes soient-elles.
Pour les familles canadiennes qui peinent déjà à joindre les deux bouts, ces révélations constituent un réveil brutal sur l’ampleur réelle de leur fardeau fiscal. Une réalité que peu de contribuables soupçonnent vraiment lorsqu’ils examinent leurs différentes factures tout au long de l’année.
L’index révèle une transformation profonde de la société canadienne, où l’État prélève désormais une part plus importante des revenus familiaux que ce que les familles consacrent à leurs besoins essentiels. Une évolution qui mérite certainement une réflexion approfondie sur l’équilibre, de plus en plus fragile, entre les services publics offerts et la capacité réelle des citoyens à soutenir financièrement l’État.