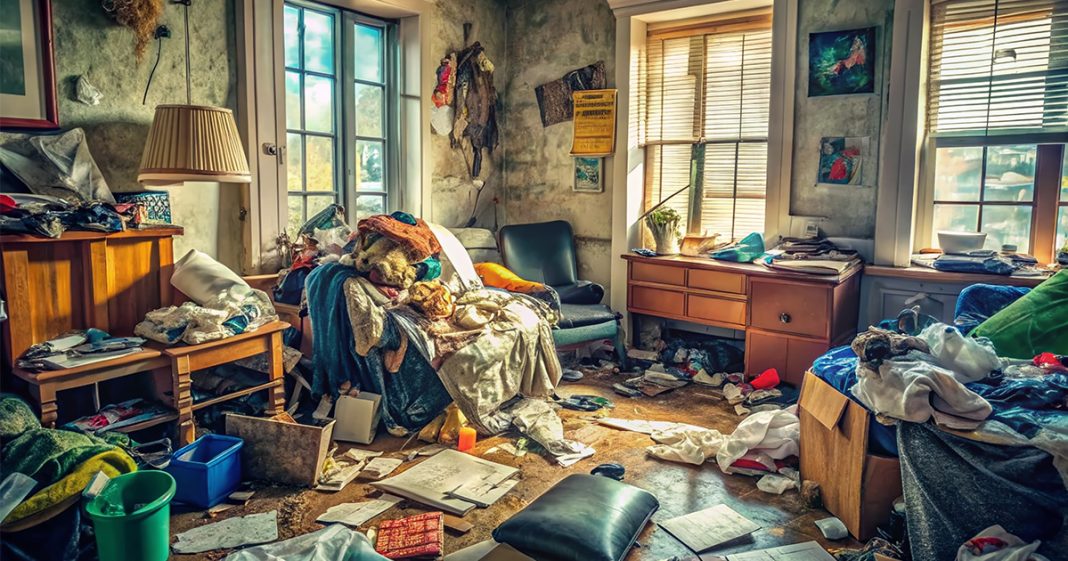Le gouvernement Legault a déposé le projet de loi 1, présenté comme une constitution pour le Québec. Mais voici un fait essentiel que le gouvernement ne crie pas sur les toits : le Québec avait déjà une constitution. Ce nouveau texte de plus de 240 articles ne crée pas une constitution de toutes pièces, il tente plutôt de la réécrire en affaiblissant sérieusement les mécanismes qui protègent les citoyens face au pouvoir de l’État.
Le Québec avait déjà une constitution
Contrairement à ce que laisse entendre la rhétorique gouvernementale, le Québec possédait bel et bien une constitution avant le projet de loi 1. Cette constitution existait sous deux formes complémentaires.
D’abord, la constitution formelle : des textes écrits comme la Loi constitutionnelle de 1867 (l’ancien Acte de l’Amérique du Nord britannique), qui définit les pouvoirs des provinces canadiennes.
Ensuite, la constitution matérielle : l’ensemble des conventions constitutionnelles, des coutumes, des principes non écrits et des lois fondamentales qui encadrent le fonctionnement de l’État québécois. La Charte québécoise des droits et libertés, adoptée en 1975, fait partie de cette constitution matérielle et a un statut supérieur aux lois ordinaires.
Le projet de loi 1 ne crée donc pas une constitution là où il n’y en avait pas. Il tente plutôt de remplacer cette constitution existante par une nouvelle version formelle qui change fondamentalement l’équilibre des pouvoirs au détriment des citoyens.
Une « loi des lois » qui reste une simple loi
Le projet de loi 1 se proclame « la loi des lois » et affirme sa primauté sur toutes les autres règles. Mais voici le problème majeur : malgré son titre pompeux de « Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec », ce texte demeure techniquement une simple loi ordinaire.
Qu’est-ce que ça signifie concrètement? Que n’importe quel gouvernement futur pourra la modifier ou même l’abolir complètement avec une simple majorité à l’Assemblée nationale. Pas besoin de référendum, pas besoin de consultation populaire, pas besoin de majorité qualifiée. Juste 50% des députés plus un.
Comparons avec une vraie constitution comme celle du Canada : pour la modifier, il faut parfois l’accord de sept provinces représentant 50% de la population canadienne, parfois l’unanimité des provinces, selon ce qu’on veut changer. Ces mécanismes rigides existent pour protéger les droits fondamentaux contre les changements d’humeur politique.
Le projet de loi 1 n’a aucune de ces protections. Un futur gouvernement du Parti libéral ou de Québec solidaire pourrait tout simplement le jeter à la poubelle et recommencer à zéro. Cette fragilité fait de ce texte davantage un instrument politique partisan qu’une véritable constitution destinée à traverser les générations.
Les contre-pouvoirs dans une démocratie : rappel essentiel
Dans une démocratie saine, plusieurs mécanismes protègent les citoyens contre les abus de pouvoir. D’abord, les tribunaux peuvent invalider les lois qui violent les droits fondamentaux. Ensuite, le Parlement lui-même agit comme contre-pouvoir : l’opposition questionne le gouvernement, les commissions parlementaires examinent les projets de loi, les députés peuvent voter selon leur conscience, même si ce dernier point est très rare au Québec avec la ligne de parti.
Les organismes indépendants jouent aussi un rôle crucial : le Protecteur du citoyen reçoit les plaintes des citoyens, le Vérificateur général surveille les dépenses publiques, le Commissaire à la lutte contre la corruption enquête sur les malversations. Ces institutions répondent au Parlement, pas au gouvernement du jour.
Les médias constituent un autre garde-fou essentiel : enquêtes journalistiques, révélations d’abus, débats publics. La société civile organise la résistance démocratique : manifestations, groupes de pression, pétitions, mobilisation populaire. Enfin, les élections elles-mêmes représentent le contre-pouvoir ultime : les citoyens peuvent chasser un gouvernement qui abuse de son pouvoir.
Le projet de loi 1 touche à plusieurs de ces mécanismes. Voyons comment.
Le pouvoir judiciaire : neutralisé sur commande
Le gouvernement pourra désormais inclure dans n’importe quelle loi une « disposition de souveraineté parlementaire » qui empêche les juges de vérifier si elle respecte vos droits. Plus troublant : le texte précise qu’il n’est « pas requis de la contextualiser ou de la justifier ». Le gouvernement n’a donc même pas à expliquer pourquoi il se soustrait au contrôle judiciaire.
Concrètement, si le gouvernement adopte une loi qui restreint la liberté d’expression et qu’il y ajoute cette clause magique, aucun juge ne pourra examiner si c’est justifié. Le gouvernement peut même l’utiliser « en réponse à une décision judiciaire » qui ne fait pas son affaire. Autrement dit : si un tribunal invalide une loi gouvernementale, le gouvernement peut simplement la réadopter avec une clause qui la met à l’abri de tout contrôle judiciaire futur.
Le projet de loi donne aussi des instructions directes aux juges. Ils doivent désormais interpréter les lois en leur donnant « un sens conforme à l’intention du législateur ». Le rôle du juge n’est plus d’équilibrer les droits ou de protéger les citoyens, mais d’appliquer ce que le gouvernement voulait dire, point final.
Un juge ne pourra même plus soulever de lui-même une question sur la constitutionnalité d’une loi. Actuellement, si un juge remarque qu’une loi viole les droits fondamentaux, il peut le signaler de sa propre initiative grâce à sa « connaissance d’office » du droit. Désormais, il devra attendre qu’une partie le fasse. Si personne ne s’en rend compte sauf le juge, la loi inconstitutionnelle restera en vigueur jusqu’à ce qu’un autre cas surgisse.
Si vous voulez contester une loi et demander sa suspension temporaire, les critères deviennent presque impossibles à respecter. Vous devrez prouver un préjudice « réel, sérieux et irréparable » avec « des éléments de preuve précis et détaillés ». Les hypothèses, les craintes raisonnables ou les risques probables ne suffisent plus. Le tribunal doit présumer automatiquement que la loi « a été adoptée dans l’intérêt public ». Vous partez donc avec un handicap majeur : la loi est présumée bonne, et c’est à vous de prouver le contraire avec des preuves en béton.
Les groupes de défense des droits : asphyxiés financièrement
Le projet de loi interdit à tout organisme financé par l’État québécois d’utiliser cet argent pour contester une loi que le gouvernement a déclarée protectrice de « la nation québécoise ». Cette mesure vise directement la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui a contesté la loi 21 sur la laïcité, mais elle s’applique aussi à la Ligue des droits et libertés, à la Commission des droits de la personne et à tous les groupes qui dépendent du financement public.
Si un organisme enfreint cette règle, ses dirigeants devront personnellement rembourser les sommes utilisées. Cette menace de responsabilité personnelle aura un effet dissuasif majeur : qui voudra risquer sa maison pour défendre les droits d’autrui?
Le déséquilibre devient flagrant : si le gouvernement abuse de son pouvoir, les citoyens devront payer de leur poche pour se défendre, tandis que le gouvernement dispose de fonds illimités — précisément parce qu’il a accès aux poches des contribuables. Les citoyens ordinaires, les petits groupes communautaires et les personnes vulnérables perdent ainsi leurs meilleurs alliés.
Le Parlement : peu affecté directement
Le projet de loi ne change pas le fonctionnement de l’Assemblée nationale. Les députés gardent leurs pouvoirs : débattre, questionner le gouvernement, voter contre les projets de loi. L’opposition n’est pas muselée.
Le projet donne toutefois au gouvernement un nouveau pouvoir : émettre des « directives de préservation de l’autonomie constitutionnelle » qui ordonnent à ses propres ministères de refuser l’argent fédéral, de rompre des ententes avec Ottawa ou de boycotter les travaux parlementaires fédéraux. Ces directives sont publiées à la Gazette officielle sans vote à l’Assemblée nationale.
Exemple concret : si Ottawa lance un nouveau programme de financement en santé, le gouvernement québécois pourrait ordonner à tous ses ministères de refuser cet argent par simple directive, sans débat parlementaire. Les députés de l’opposition ne pourraient pas s’y opposer formellement.
Le projet crée aussi des séances parlementaires annuelles obligatoires pour débattre des enjeux constitutionnels. C’est un ajout positif qui renforce le rôle du Parlement. Mais face aux autres affaiblissements des contre-pouvoirs — tribunaux neutralisés, groupes de défense privés de financement, accès à la justice compliqué — cette amélioration reste modeste.
Les organismes indépendants : sérieusement limités
Plusieurs organismes indépendants sont directement touchés par le projet de loi, notamment la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Ces organismes ne pourront plus utiliser leurs fonds publics pour contester une loi que le gouvernement a déclarée protectrice de « la nation québécoise ». C’est problématique parce que la Commission des droits de la personne a précisément pour mandat de protéger les droits fondamentaux. Si le gouvernement adopte une loi qui viole ces droits mais la déclare protectrice de la nation, la Commission ne pourra plus faire son travail.
D’autres organismes comme le Protecteur du citoyen ou le Vérificateur général conservent leurs pouvoirs habituels. Le Vérificateur pourra même enquêter pour vérifier que des organismes n’ont pas illégalement utilisé des fonds publics pour contester ces lois. Autrement dit : il surveillera à ce que personne ne défende trop les droits des citoyens.
Les médias et la liberté de presse : une zone grise inquiétante
Le projet de loi n’interdit pas explicitement aux médias de critiquer le gouvernement. La liberté de presse reste protégée par la Charte québécoise des droits et libertés.
Mais voici le problème : plusieurs médias québécois reçoivent des subventions publiques, que ce soit des crédits d’impôt, des aides financières directes ou des contrats gouvernementaux. Si un média financé par l’État décidait de contester judiciairement une loi déclarée protectrice de « la nation québécoise », pourrait-il utiliser cet argent public pour payer ses avocats?
L’interdiction stipule qu’« aucun organisme » ne peut utiliser « des sommes provenant du fonds consolidé du revenu » pour contester ces lois. Techniquement, un média qui reçoit des subventions publiques pourrait être visé. La formulation est large et floue.
Même si les médias conservent leur droit de critiquer et d’enquêter, cette ambiguïté pourrait créer un effet refroidissant. Si les groupes de défense des droits sont muselés financièrement et que les médias hésitent à s’engager dans des batailles juridiques par crainte de perdre leurs subventions, qui reste-t-il pour défendre les citoyens?
La société civile : libre, mais moins outillée
Le projet de loi ne restreint pas le droit de manifester, de créer des groupes de pression ou de mobiliser l’opinion publique. Les citoyens conservent leur liberté d’association et d’expression.
Le problème surgit au niveau des ressources. Les organisations de la société civile qui dépendent du financement public ne pourront plus utiliser cet argent pour des contestations juridiques concernant les lois protectrices de « la nation québécoise ». Cela réduit leur capacité d’action concrète, même si leur liberté de parole reste intacte.
Les groupes devront choisir : accepter le financement public et renoncer aux recours juridiques, ou refuser ce financement et chercher d’autres sources de revenus. Cette pression financière pourrait affaiblir le tissu associatif québécois.
Les élections : un contre-pouvoir affaibli entre les scrutins
Le processus électoral n’est pas touché : les citoyens gardent leur droit de vote et peuvent chasser un gouvernement abusif. Les élections restent libres.
Mais une zone grise majeure émerge : les partis politiques québécois sont financés en grande partie par l’État via le DGEQ. Or, le projet de loi interdit à « tout organisme » utilisant des fonds publics de contester les lois déclarées protectrices de « la nation québécoise ». Un parti d’opposition pourrait-il être visé par cette interdiction? Le texte ne le précise pas, mais la formulation est assez large pour l’englober.
Entre les élections, le gouvernement dispose donc d’un champ libre considérable. Un gouvernement élu avec 40% des voix pourrait adopter des lois controversées, y ajouter des clauses de souveraineté parlementaire, empêcher leur contestation financée par l’État — possiblement même par les partis d’opposition — et les maintenir en place pendant quatre ans jusqu’au prochain scrutin.
Vos droits personnels : une vision collectiviste inquiétante
Le projet de loi inclut la Charte québécoise des droits et libertés dans sa constitution. Vos droits fondamentaux restent reconnus sur papier : liberté d’expression, liberté de religion, égalité, vie privée, etc.
Mais attention au changement majeur. Le texte stipule désormais que vos droits et libertés sont « inséparables des droits et libertés d’autrui, du bien commun et des droits collectifs de la nation québécoise ». Qu’est-ce que ça signifie en pratique? Que vos droits personnels n’existent plus en soi, mais seulement dans la mesure où ils sont compatibles avec ce que le gouvernement définit comme le « bien commun » et les « droits collectifs ».
Le danger, c’est que ces concepts flous peuvent être utilisés par n’importe quel gouvernement pour justifier à peu près n’importe quoi. Imaginons trois scénarios différents :
Un gouvernement écologiste radical décide que le bien commun, c’est la survie de la planète : il pourrait invoquer cette disposition pour interdire les automobiles privées au nom des droits collectifs de la nation.
Un gouvernement populiste autoritaire décide que le bien commun, c’est la sécurité nationale et l’ordre public : il pourrait déclarer certains médias « ennemis de la nation », bloquer l’accès à des sites web jugés « déstabilisants », forcer les journalistes à révéler leurs sources au nom de la sécurité collective, ou même criminaliser certaines formes de critique politique en les qualifiant d’atteintes aux « droits collectifs de la nation québécoise ». Tout cela pourrait être justifié par les concepts flous de « bien commun » et de « droits collectifs » inscrits dans cette constitution.
Un gouvernement religieux radical pourrait aller encore plus loin : puisque cette constitution n’est qu’une simple loi modifiable à 50% plus un des députés , il pourrait renverser la hiérarchie actuelle et décréter que la liberté de religion prime désormais sur l’égalité hommes-femmes, lui permettant ensuite de limiter drastiquement les libertés individuelles au nom d’une vision théocratique des droits collectifs.
Le texte établit aujourd’hui une hiérarchie rigide : en cas de conflit entre l’égalité hommes-femmes et la liberté de religion, l’égalité l’emporte automatiquement. Mais cette règle peut être modifiée demain par une simple majorité parlementaire. C’est un précédent dangereux : si le gouvernement actuel peut décréter qu’un droit prime toujours sur un autre, rien n’empêchera un gouvernement futur d’établir d’autres hiérarchies selon ses priorités politiques.
Le projet de loi consacre des pages entières aux « droits collectifs de la nation », tandis que les droits individuels sont relégués à la Charte québécoise, elle-même désormais subordonnée à ces droits collectifs.
La nation y est présentée comme une entité distincte ayant ses propres droits, plutôt que comme la somme des citoyens qui la composent. Cette vision collectiviste inverse la logique démocratique normale : au lieu que la nation serve les individus qui la forment, ce sont les individus qui doivent se subordonner aux intérêts de cette entité abstraite.
Un nouveau Conseil constitutionnel : contre-pouvoir ou chambre d’écho?
Le projet de loi crée un Conseil constitutionnel de cinq membres nommés selon « leur sensibilité et leur intérêt marqués pour la protection des droits collectifs de la nation québécoise ». Remarquez le critère : pas l’indépendance d’esprit, pas l’expertise juridique variée, pas la défense équilibrée des droits individuels ET collectifs. Non, seulement la « sensibilité » à une vision particulière, les droits collectifs.
Ce conseil donnera des avis au gouvernement sur l’interprétation de la constitution, mais ces avis devront être unanimes. Aucun membre ne pourra publiquement exprimer son désaccord. Cette unanimité forcée fait de ce conseil un amplificateur des positions gouvernementales plutôt qu’un véritable contre-pouvoir.
De plus, le conseil ne rend des avis que si le gouvernement ou l’Assemblée nationale le lui demande. Il n’a aucun pouvoir d’initiative. Il ne peut pas s’autosaisir d’une question constitutionnelle problématique. C’est un outil consultatif au service du pouvoir, pas un garde-fou indépendant.
Le gouvernement québécois dispose déjà d’un mécanisme pour obtenir des avis constitutionnels : il peut renvoyer des questions à la Cour d’appel du Québec, tout comme le fédéral peut en renvoyer à la Cour suprême. Ce mécanisme existe depuis toujours et a été utilisé à maintes reprises.
Pourquoi créer un nouveau conseil? La création de cette institution parallèle suggère un manque de confiance envers les tribunaux existants. Le gouvernement préfère manifestement avoir son propre conseil idéologiquement aligné, composé de membres choisis pour leur « sensibilité » aux droits collectifs, plutôt que de faire confiance aux juges indépendants.
Le contrôle du territoire : limiter vos droits de propriété
Le projet de loi donne au gouvernement québécois un droit de premier refus sur toute vente d’immeuble à une institution fédérale. Si vous voulez vendre votre propriété au fédéral, vous devrez d’abord en informer Québec, qui pourra l’acheter à votre place aux mêmes conditions. Si vous ne respectez pas cette règle, votre vente sera automatiquement nulle.
Cette mesure limite votre droit de propriété et votre liberté de choisir à qui vous vendez. On peut comprendre l’intention (préserver le territoire québécois), mais le résultat concret, c’est que l’État peut s’immiscer dans vos transactions privées. C’est une atteinte directe à votre liberté contractuelle.
Un détail révélateur : cette restriction ne s’applique qu’aux ventes au gouvernement fédéral, pas aux gouvernements étrangers. Si vous voulez vendre votre immeuble au consulat d’un pays étranger, vous êtes libre de le faire sans en informer Québec. Mais si vous voulez le vendre à Ottawa, là il faut l’autorisation du gouvernement québécois. Cette approche sélective suggère que la mesure vise davantage les relations fédérales-provinciales que la véritable protection du territoire.
Des concepts flous et dangereux
Le projet de loi utilise abondamment des concepts vagues et non définis qui pourraient servir à justifier à peu près n’importe quoi.
La « nation québécoise » : ce terme revient constamment dans le projet de loi, mais n’est jamais clairement défini. Est-ce synonyme de « peuple québécois »? Le texte alterne entre les deux termes sans préciser la distinction. La nation y est présentée comme une entité ayant des droits propres, distincte des citoyens qui la composent.
Les « valeurs sociales distinctes » : le texte affirme que la nation québécoise a des valeurs sociales distinctes, mais ne précise jamais lesquelles. L’égalité hommes-femmes? C’est aussi une valeur canadienne. Le français? C’est une question de langue, pas de valeurs sociales. Ces valeurs restent mystérieusement non définies.
Le « bien commun » : vos droits sont désormais inséparables du bien commun, mais le texte ne définit jamais ce qu’est ce bien commun. Qui le définit? Le gouvernement du jour. Cette absence de définition donne au pouvoir politique une latitude dangereuse.
Le « modèle d’intégration à la nation québécoise » : le texte affirme que ce modèle « se distingue du multiculturalisme canadien », mais ne précise jamais en quoi il consiste concrètement. On devine qu’il faut parler français et adopter certaines coutumes, mais rien n’est explicitement défini.
Ces concepts flous sont dangereux parce qu’ils donnent au gouvernement une latitude énorme pour interpréter la constitution comme bon lui semble, au gré des circonstances politiques.
Les symboles qui cachent les enjeux réels
Le projet de loi abolit le lieutenant-gouverneur, remplacé par un « officier du Québec » nommé directement par le premier ministre. Le texte proclame que « le Québec n’a pas d’attachement au régime monarchique ». Il affirme que « le français est la seule langue commune », que « l’État est laïque » et que « le modèle d’intégration se distingue du multiculturalisme canadien ».
Le projet constitutionnalise aussi l’avortement en protégeant « la liberté des femmes d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Cette protection est absolue, sans aucune limite de temps ou condition. Des questions légitimes surgissent : qu’arrive-t-il à un député qui croit que l’avortement devrait être encadré à 37 semaines de grossesse — le stade où un bébé est pleinement viable — sauf en cas de danger pour la mère? Peut-il encore siéger à l’Assemblée nationale alors qu’il doit prêter serment de « défendre la Constitution du Québec » ? Peut-il proposer des amendements législatifs sans violer son serment constitutionnel?
Le projet transforme ainsi une question éthique complexe — sur laquelle les gens raisonnables peuvent être en désaccord — en dogme constitutionnel inattaquable. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de positions politiques controversées qui se retrouvent constitutionnalisées plutôt que débattues démocratiquement.
Ces déclarations identitaires et symboliques occupent des pages entières. Elles sont conçues pour mobiliser l’appui populaire autour de symboles rassembleurs. Mais pendant qu’on débat de monarchie, de laïcité et d’avortement, on néglige l’essentiel : les mécanismes concrets qui protègent chaque citoyen contre les abus de pouvoir, quel que soit le gouvernement au pouvoir.
Un document politique, pas une constitution
Une vraie constitution protège les citoyens contre l’État. Elle établit des limites que le pouvoir politique ne peut pas franchir, même avec l’appui de la majorité. Elle garantit qu’une personne seule, impopulaire ou marginale peut se défendre contre le gouvernement le plus puissant.
Le projet de loi 1 fait l’inverse. Il ressemble davantage à un instrument politique partisan qu’à un véritable consensus constitutionnel. C’est un projet de la CAQ, déposé sans large consultation ou consensus de l’Assemblée nationale et du peuple québécois.
Il renforce les pouvoirs de l’État tout en affaiblissant plusieurs contre-pouvoirs démocratiques. Les tribunaux sortent considérablement affaiblis : ils ne peuvent plus contrôler les lois avec des clauses de souveraineté parlementaire, doivent présumer de la bonne foi du gouvernement, et ne peuvent plus s’autosaisir de questions constitutionnelles. Les groupes de défense des droits perdent leur financement pour contester les lois. L’accès à la justice devient un parcours semé d’embûches.
Les contre-pouvoirs ne disparaissent pas complètement. Le Parlement garde son rôle, l’opposition peut encore questionner, les médias peuvent enquêter, les citoyens peuvent manifester, et les élections demeurent libres. Mais l’équilibre global penche nettement en faveur du gouvernement au détriment des mécanismes de protection des citoyens.
L’entrée en vigueur est prévue pour le 24 juin 2026, jour de la fête nationale. Ce choix de date vise à enrober ces changements juridiques majeurs dans une célébration identitaire. Mais une fois la fête passée, ce sont les conséquences concrètes qui resteront : un État plus puissant, des citoyens moins bien protégés, des contre-pouvoirs affaiblis.
La question n’est pas de savoir si vous êtes pour ou contre l’affirmation nationale du Québec. La question est de savoir si vous acceptez qu’un gouvernement, quel qu’il soit, puisse adopter des lois sans véritable contrôle judiciaire et sans que les citoyens aient les outils pour se défendre efficacement. Parce que les gouvernements changent, mais les pouvoirs qu’on leur donne restent. Et cette « constitution » elle-même peut être modifiée ou abolie par une simple majorité de députés, demain matin, si le vent politique tourne.