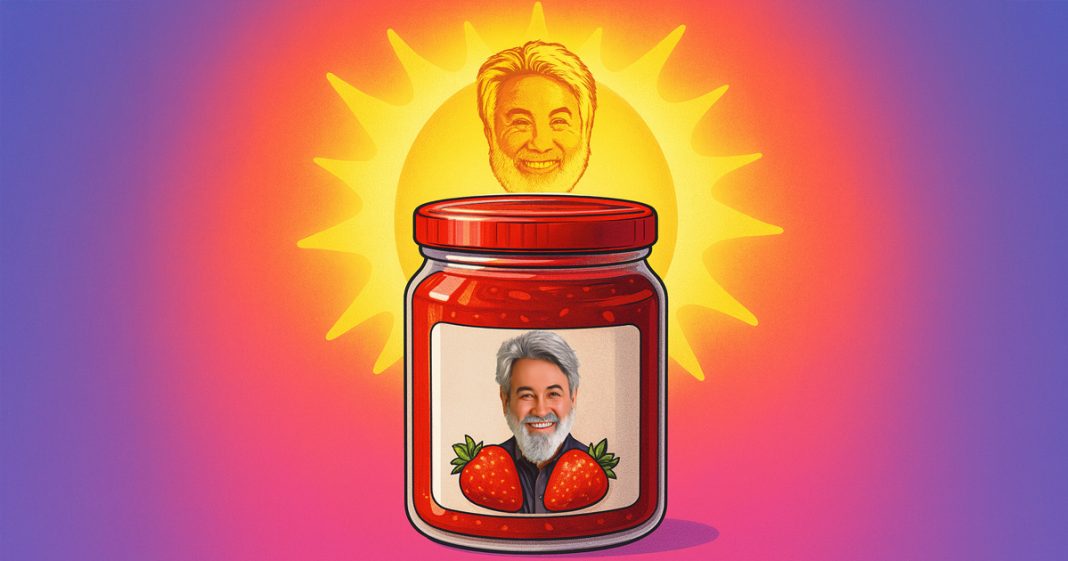Au cours des trois dernières décennies, la nature de l’OTAN et le rôle de l’Europe en son sein ont évolué de manière spectaculaire en réponse à un ordre géopolitique en mutation. Au cœur de cette transformation se trouve la question de savoir comment les États-Unis perçoivent l’engagement de l’Europe en faveur de la défense collective et la notion d’autonomie stratégique européenne. Si les États-Unis constituent depuis longtemps l’épine dorsale de la capacité militaire de l’OTAN, ils se méfient également de plus en plus de la dépendance européenne et des ambitions rhétoriques d’indépendance qui ne s’accompagnent souvent pas d’investissements réels. Ces perceptions ne sont pas uniformes et sont façonnées par de profondes différences dans la manière dont des pays tels que la France et l’Allemagne considèrent l’implication des États-Unis, par rapport à des États de la ligne de front tels que les pays baltes et la Pologne. Alors que l’OTAN s’oriente vers un nouvel objectif de 5 % pour les dépenses de défense, le moment est venu pour l’Europe d’aligner ses ambitions sur des actions crédibles et de parler d’une seule voix pour sécuriser le continent.
1. Le point de vue américain : Frustration, ambiguïté et soutien conditionnel
Comme le montre l’étude 2025 de Heljä Ossa, « European strategic autonomy in the transatlantic security context : American perceptions… », l’attitude des États-Unis à l’égard de l’intégration de la défense européenne est beaucoup plus nuancée et fragmentée que ne le supposent souvent les responsables politiques européens. Au cours de cinq administrations présidentielles, les dirigeants politiques américains — républicains comme démocrates — ont exprimé leur scepticisme à l’égard de la quête d’autonomie de l’UE en matière de sécurité. La préoccupation n’a jamais été que l’Europe devienne trop forte, mais plutôt que les ambitions européennes en matière de défense fassent double emploi avec l’OTAN ou l’affaiblissent.
Les présidents, de George W. Bush à Joe Biden, ont toujours exprimé une attente simple : L’Europe devrait dépenser plus, agir plus et se plaindre moins. Donald Trump s’est montré particulièrement loquace, qualifiant fréquemment l’OTAN d’« obsolète » et réprimandant les alliés pour ne pas avoir atteint leur objectif de 2 % du PIB. Mais même sous Obama et Biden, la diplomatie américaine a clairement indiqué que l’écart de partage du fardeau était insoutenable. L’opinion dominante à Washington est que l’Europe s’est confortablement installée sous le parapluie sécuritaire des États-Unis, mais qu’elle continue d’invoquer l’autonomie stratégique sans les investissements ou la cohésion nécessaires.
En outre, les recherches de M. Ossa démontrent que les décideurs politiques américains, y compris les groupes de réflexion, les universitaires et les analystes militaires, présentent un large éventail de points de vue. Certains affirment que l’autonomie stratégique de l’Europe n’est pas seulement souhaitable, mais nécessaire, en particulier si les États-Unis s’orientent davantage vers l’Indo-Pacifique. Selon eux, cela permettrait aux États-Unis de se concentrer sur la Chine tout en faisant confiance à l’Europe pour gérer sa propre périphérie. Mais ce soutien est assorti de conditions : l’UE doit fournir des capacités tangibles et ne pas se contenter de vaines promesses.
2. La vision franco-allemande : L’autonomie comme émancipation
En Europe, la France et l’Allemagne représentent le moteur intellectuel et politique de l’agenda de l’autonomie stratégique. La France, en particulier, milite depuis longtemps pour que l’Europe agisse en tant que « puissance souveraine », capable d’intervenir militairement sans toujours s’appuyer sur l’OTAN. Depuis Charles de Gaulle, la France souhaite une Europe plus indépendante, capable d’agir de manière décisive en cas de crise et de défendre ses valeurs sans s’en remettre à Washington.
Le président Emmanuel Macron a qualifié l’OTAN de « mort cérébrale » et a appelé à un pilier européen plus fort au sein de l’alliance, un pilier qui n’attende pas la permission ou la protection des États-Unis. La France considère l’autonomie comme une force et comme une adaptation nécessaire à la volatilité de la politique américaine, en particulier à la lumière des menaces de Trump de se retirer de l’OTAN.
L’Allemagne, bien qu’historiquement plus prudente, a changé radicalement de position après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Le discours Zeitenwende du chancelier Olaf Scholz a marqué un changement de paradigme dans la pensée sécuritaire allemande, avec des augmentations importantes des dépenses de défense et un soutien politique pour un rôle plus affirmé de l’UE en matière de défense. Pourtant, l’Allemagne reste limitée par la culture politique, les obstacles juridiques et la prudence budgétaire. Sa version de l’autonomie est plus progressive et multilatérale que celle de la France, ancrée dans la cohésion européenne et la complémentarité avec l’OTAN.
Les deux pays sont généralement favorables à un approfondissement de la coopération de l’UE en matière de défense, à un renforcement des capacités industrielles et à une plus grande indépendance dans la prise de décision, mais toujours dans le cadre d’une complémentarité avec l’OTAN, et non d’une structure rivale. Néanmoins, leur aspiration à la « souveraineté stratégique » suscite la méfiance de Washington et du flanc oriental de l’OTAN.
3. Le point de vue balte et polonais : L’autonomie comme risque
En revanche, les États baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) et la Pologne ont un point de vue beaucoup plus pragmatique et axé sur la sécurité. Pour ces pays, qui ont une frontière avec la Russie ou le Belarus, l’OTAN — et plus particulièrement la présence militaire américaine — n’est pas seulement importante, elle est existentielle.
Ces quatre pays partagent une histoire récente de domination soviétique et restent les plus exposés à l’agression russe. Pour eux, la crédibilité de la dissuasion ne dépend pas des déclarations européennes d’autonomie, mais de la présence physique de troupes américaines, de défenses aériennes et d’un soutien nucléaire.
Ces États ont pris des mesures en conséquence. La Pologne consacre désormais plus de 4 % de son PIB à la défense et modernise rapidement son armée. Elle a accueilli d’importants déploiements de l’OTAN et des forces américaines bilatérales. Les pays baltes n’ont cessé de réclamer une présence avancée, des groupements tactiques tournants et des capacités élargies en matière de missiles et de surveillance.
Pour Varsovie, Riga, Tallinn et Vilnius, l’autonomie stratégique n’est acceptable que si elle renforce l’OTAN, et non si elle sape l’unité transatlantique. Il existe une profonde méfiance à l’égard de toute initiative qui pourrait être interprétée à Moscou comme un signe de désengagement des États-Unis ou de division de l’Europe.
En résumé, alors que la France recherche l’autonomie par rapport aux États-Unis, la Pologne et les États baltes mettent l’accent sur la cohésion de l’alliance en tant que moyen de dissuasion, en lui donnant la priorité sur l’indépendance institutionnelle.
4. Le nouvel objectif de 5 % de l’OTAN : Un test de résistance pour la crédibilité
Lors du sommet de l’OTAN de juin 2025 à La Haye, l’alliance a adopté un nouvel objectif ambitieux : les membres sont désormais censés consacrer 5 % de leur PIB aux investissements liés à la défense d’ici à 2035.
Cela comprend :
- 3,5 % pour la défense de base (troupes, armes, état de préparation)
- 1,5 % pour la défense et la sécurité au sens large (par exemple, infrastructure, cybersécurité, résilience énergétique).
Ce nouvel objectif est une réponse directe à :
- À la guerre que mène actuellement la Russie en Ukraine et à la menace d’une future escalade.
- Les avertissements selon lesquels Moscou pourrait mettre à l’épreuve la détermination de l’OTAN d’ici cinq ans.
- Des craintes croissantes qu’une deuxième présidence Trump puisse réduire ou conditionner le soutien américain.
L’augmentation de 2 % à 5 % est monumentale. Bien que 22 des 32 membres de l’OTAN aient atteint l’objectif précédent de 2 % en 2024, peu d’entre eux sont prêts à atteindre le nouvel objectif de 5 %, surtout si l’on tient compte de la nécessité d’une infrastructure et d’une résilience plus larges. Des pays comme l’Espagne ont déjà fait part de leur résistance, tandis que des États fiscalement conservateurs comme l’Allemagne et les Pays-Bas préfèrent les prêts aux subventions.
L’UE a mis en place un mécanisme de prêt de 150 milliards d’euros et a assoupli les règles en matière de déficit pour permettre aux pays d’augmenter leurs dépenses de défense sans encourir de pénalités. Malgré cela, de nombreux États n’ont toujours pas la volonté politique de faire face à l’ampleur et à l’urgence exigées par ce nouvel environnement de sécurité.
5. Conclusion : Il est temps pour l’Europe de s’aligner, d’investir et de tenir ses promesses
La voie à suivre est claire, mais elle n’est pas facile.
L’Europe doit concilier la vision de l’autonomie avec l’impératif de l’unité. Elle doit comprendre que la crédibilité stratégique commence par la crédibilité budgétaire. L’objectif récemment fixé par l’OTAN d’allouer 5 % du PIB à la défense constitue un outil puissant pour démontrer l’engagement et l’état de préparation, mais seulement si les États membres cessent de chercher des excuses et assument une responsabilité partagée.
À la France et à l’Allemagne : l’autonomie exige un consensus, pas l’abstraction. En Pologne et aux pays baltes : la dissuasion exige la solidarité, pas la divergence. À l’UE dans son ensemble : la sécurité n’est pas gratuite. Et la prochaine crise pourrait ne pas donner d’avertissement.
Comme le montre Ossa (2025), le soutien des États-Unis n’est pas inconditionnel. Il dépend du sérieux perçu. Si l’Europe veut façonner l’ordre du XXIe siècle, elle doit démontrer sa capacité à agir, et pas seulement à débattre.
Le message américain a été remarquablement cohérent : « Nous nous montrerons, mais vous aussi ».
L’Europe doit répondre à cette attente, non pas pour Washington, mais pour ses propres citoyens. Le temps de la défense est venu.
Sources :
Bayer, L., & Gray, A. (2025). What is NATO’s new 5% defence spending target?. Reuters, https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/what-is-natos-new-5-defence-spending-target-2025-06-23/
Ossa, H. (2025). European strategic autonomy in the transatlantic security context: American perceptions of European security and defence integration, 1998–2022. European Security, 34(1), 17–40. https://doi.org/10.1080/09662839.2025.2464530
Ünaldilar, S., Aydoğan Ünal, B., & Kumova Metin, S. (2025). Navigating the storm: The impact of the Russia–Ukraine war on EU’s quest for strategic autonomy. European Security, 34(2), 135–160. https://doi.org/10.1080/09662839.2025.2517031