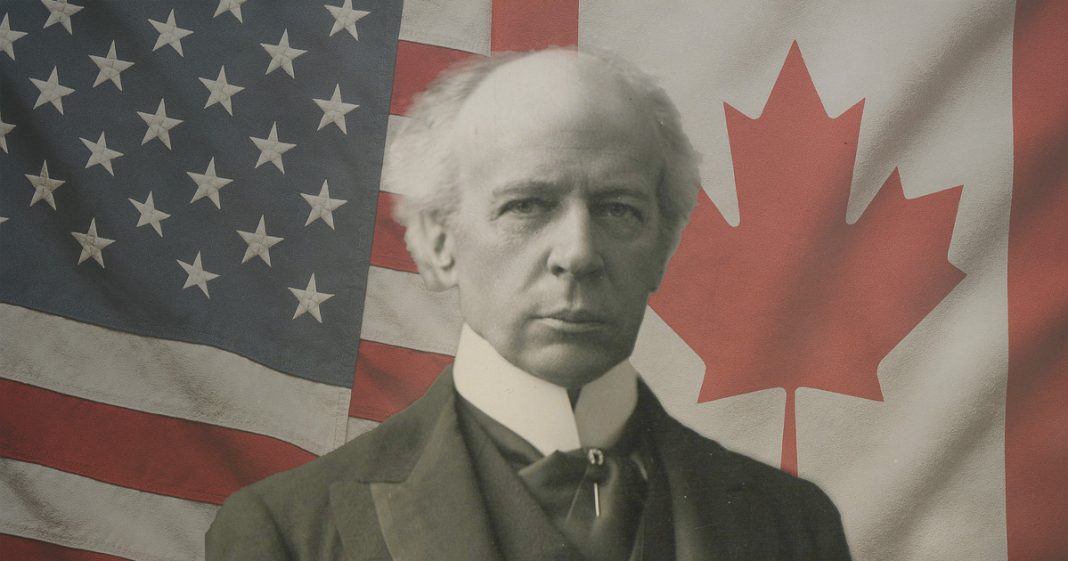Adam Smith aurait adoré les « givers » (même s’ils n’ont pas lu Smith)
Dans Give and Take, l’auteur et psychologue Adam Grant bouscule une idée reçue : les personnes les plus performantes ne sont pas celles qui cherchent à tout prix à maximiser leur propre gain — les takers —, mais celles qui aident les autres à réussir — les givers. Cette approche peut sembler naïve dans un monde souvent obsédé par la compétition. Pourtant, elle rejoint une vérité économique fondamentale : dans un échange libre et volontaire, chacun y trouve son compte. Et c’est là qu’un pont se dessine entre la générosité bien pensée et l’intérêt personnel éclairé, tel que l’exprimait Adam Smith.
Alors, est-ce vraiment rentable d’aider les autres? Et comment l’individualisme, souvent mal compris, peut-il devenir un moteur de coopération et de prospérité partagée? Explorons ensemble ce paradoxe apparent.
Givers, takers et matchers : trois façons d’agir
Adam Grant distingue trois profils dans les relations humaines :
- Les takers recherchent avant tout leur propre avantage, parfois au détriment des autres. Ils prennent sans donner.
- Les matchers échangent en calculant la réciprocité immédiate : « Je t’aide, mais tu me dois quelque chose. »
- Les givers, eux, donnent sans attendre de retour immédiat. Ils partagent leurs idées, leur temps, leurs ressources, simplement parce qu’ils croient en la valeur de l’entraide.
Contre toute attente, ce sont souvent les givers qui réussissent le mieux… à condition de ne pas se laisser exploiter par un taker qui voudrait profiter de sa générosité. Si cette dernière est bien dosée, elle crée de la confiance, bâtit des réseaux solides et inspire la loyauté. Dans le monde professionnel, ils tirent leur force d’une valeur rare : la coopération sincère.
L’échange libre : quand chacun y gagne
En économie, un échange libre n’a lieu que si chaque partie pense y gagner. Ce principe, à la fois simple et puissant, est au cœur de toute société prospère.
Prenez un exemple banal : vous donnez 1 dollar au caissier du Tim Hortons pour un beigne. Vous préférez le beigne à votre dollar, lui préfère le dollar à son beigne. L’échange profite donc aux deux. Il en va de même pour les échanges non monétaires : un voisin répare votre clôture, vous l’aidez à déménager. Ce type de coopération, spontané et mutuellement bénéfique, ne nécessite ni contrainte ni autorité centrale.
Mais cette mécanique repose sur une condition clé : la liberté. Dès qu’un échange est forcé, ou biaisé par la tromperie, il perd sa nature gagnant-gagnant. D’où l’importance de préserver un cadre libre, transparent et fondé sur la confiance.
Adam Smith : l’intérêt personnel au service du bien commun
Adam Smith l’exprimait de manière frappante : « Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais de leur souci de leur propre intérêt. »
Cette phrase a souvent été mal comprise. Smith ne valorise pas l’égoïsme destructeur, mais souligne une vérité subtile : dans un marché libre, le souci de soi peut devenir utile aux autres. Le boulanger veut gagner sa vie, alors il vous vend un bon pain. Pour réussir, il doit satisfaire vos besoins. Voilà ce que Smith appelait la « main invisible » : un ordre spontané où chacun, en poursuivant ses propres objectifs, contribue sans le vouloir à l’intérêt général. Cette main invisible agissait dans le respect d’un cadre institutionnel respectant le droit de propriété, le droit à la vie et le droit à la liberté, concept amené par un autre philosophe des lumières écossaises dénommé John Locke.
Ce n’est donc pas l’altruisme qui fait tourner l’économie, mais l’intérêt personnel… dans un cadre où les échanges sont libres, les droits respectés, et la concurrence saine.
Le point commun : la réussite par la générosité stratégique
Peut-on vraiment concilier la générosité des givers et la logique d’Adam Smith? Absolument. Car aider les autres n’exclut pas l’intérêt personnel — au contraire.
Le giver ne donne pas par pur sacrifice, mais parce qu’il comprend qu’un environnement de confiance, d’échange et de coopération est bénéfique à long terme. Sa générosité est un investissement relationnel. Dans une entreprise, un leader qui partage son expertise ou soutient ses employés ne fait pas acte de charité : il mise sur la réussite collective pour mieux réussir lui-même.
C’est ce que l’on pourrait appeler l’intérêt personnel éclairé : comprendre que ma réussite est liée à celle des autres. Cela n’a rien d’utopique. C’est, en réalité, l’un des fondements du libéralisme classique : une société libre où chacun, en poursuivant ses objectifs, contribue à une prospérité partagée.
Conclusion : Donner, c’est aussi recevoir
Dans un monde trop souvent polarisé entre individualisme caricatural et altruisme contraint, il est temps de redécouvrir une vérité libérale simple : la coopération libre et volontaire est la plus puissante des forces sociales. En ce sens, les givers d’Adam Grant ne contredisent pas Adam Smith. Ils en sont une version moderne. Car dans une société ouverte, donner — intelligemment — est aussi une manière de réussir.