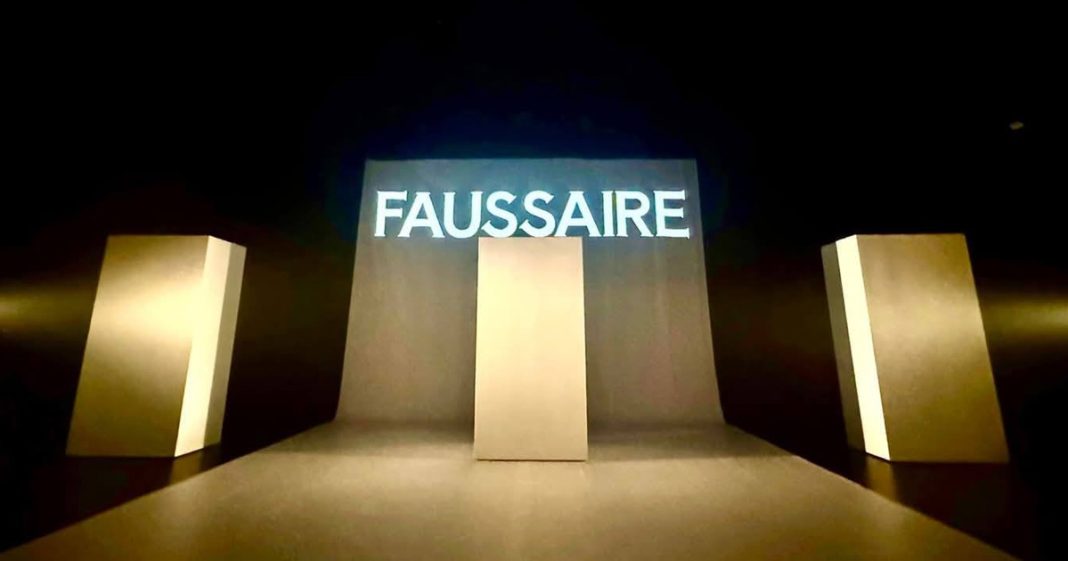Depuis l’annonce des nouveaux tarifs américains sur plusieurs produits canadiens, le premier ministre du Canada et ses homologues provinciaux ne cessent de dénoncer ces mesures comme étant une attaque directe contre les consommateurs américains. Selon eux, ces tarifs feront grimper les prix aux États-Unis et nuiront aux travailleurs et aux entreprises du pays.
Mais si l’on suit leur raisonnement, ne faudrait-il pas appliquer la même logique aux barrières commerciales imposées par le Canada aux produits américains bien avant cette crise? Car en réalité, ce ne sont pas les consommateurs américains qui ont souffert de tarifs désavantageux pendant des années, mais bien ceux du Canada et de ses provinces.
Une gestion de l’offre qui coûte cher aux Canadiens
Prenons l’exemple du secteur agricole. Depuis des décennies, le Canada applique des tarifs prohibitifs sur les produits laitiers, les œufs et la volaille en provenance des États-Unis. Ces mesures, mises en place sous le système de gestion de l’offre, ont eu pour effet d’éloigner la concurrence américaine et de maintenir artificiellement les prix élevés pour les consommateurs canadiens.
En 2018, une étude menée par l’Institut Fraser révélait que les Canadiens payaient jusqu’à deux fois plus cher leurs produits laitiers que leurs voisins américains. Un gallon de lait qui coûte 3,50 $ aux États-Unis pouvait se vendre plus de 6 $ au Canada. Cette situation n’a jamais semblé inquiéter les dirigeants fédéraux et provinciaux, qui justifient ces tarifs en prétendant protéger les producteurs locaux faisant en sorte que les Canadiens devaient payer leur beurre et leurs œufs bien plus cher que nécessaire?
Des tarifs sur les produits manufacturés : un fardeau silencieux
Le protectionnisme canadien ne s’arrête pas aux produits agricoles. Pendant des années, des tarifs plus ou moins élevés ont frappé une gamme de produits manufacturés en provenance des États-Unis, des vêtements aux électroménagers, en passant par les véhicules.
En 2017, l’Association canadienne des consommateurs soulignait que ces mesures se traduisaient par des prix gonflés pour des articles de base. Une voiture achetée au Canada coûtait souvent des milliers de dollars de plus qu’un modèle identique aux États-Unis. Pourquoi? Parce que des droits d’importation et des normes commerciales distinctes rendaient le marché moins concurrentiel.
L’équipe de négociation canadienne soutient que les tarifs imposés par l’administration Trump sur les produits canadiens auront des répercussions particulièrement négatives pour les consommateurs américains.
Toutefois, les tarifs appliqués par le Canada sur les produits américains depuis l’existence des différents accords de libre-échange ont également eu un impact négatif sur les consommateurs canadiens. Cette situation soulève des questions sur la cohérence du discours argumentaire des politiciens canadiens en matière de commerce international durant cette crise commerciale.
Un libre marché : la seule solution durable
Le gouvernement canadien dénonce aujourd’hui les mesures protectionnistes de Washington, mais la véritable solution à cette guerre commerciale ne serait-elle pas d’abolir totalement les barrières tarifaires des deux côtés de la frontière ?
Un véritable libre marché, sans droits de douane ni restrictions inutiles, permettrait enfin aux consommateurs canadiens et américains d’accéder aux meilleurs prix et aux meilleurs produits, tout en renforçant la compétitivité des entreprises des deux pays. L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) est un pas dans cette direction, mais il reste encore de nombreuses barrières artificielles qui faussent la concurrence et pénalisent les citoyens.
Plutôt que de se concentrer sur une bataille de représailles commerciales, Ottawa et Washington devraient saisir cette occasion pour réinventer leurs relations économiques. L’abolition complète des tarifs douaniers ne profiterait pas seulement aux Américains, comme le prétendent les dirigeants canadiens, mais aussi — et surtout — aux Canadiens eux-mêmes.