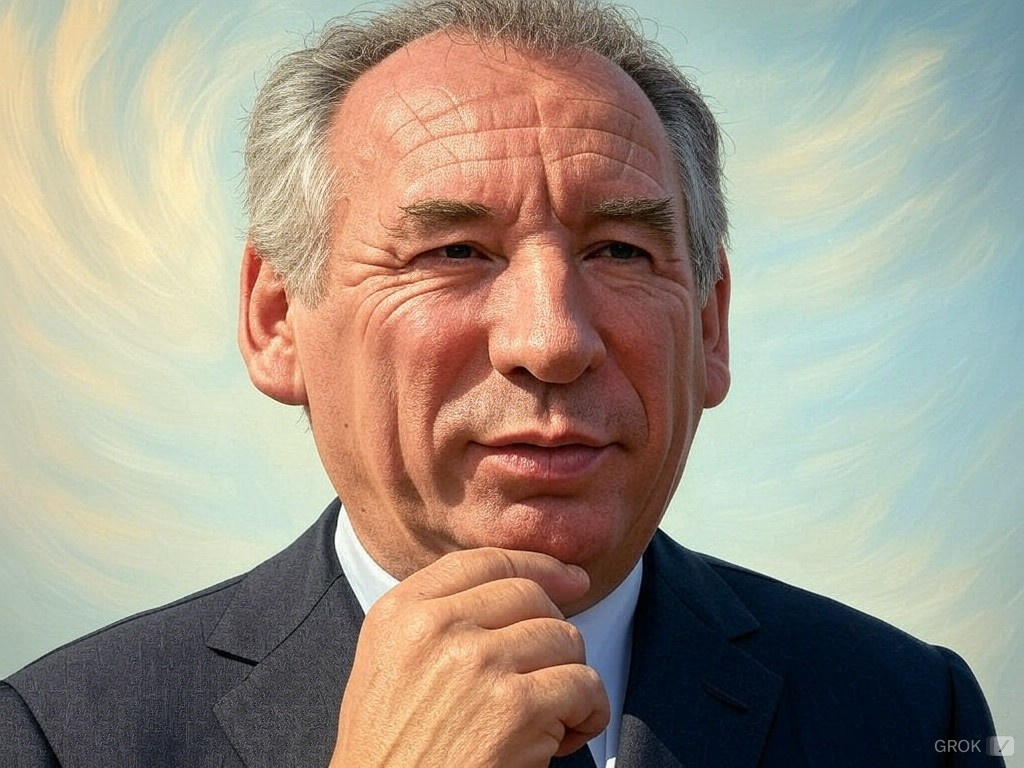FRANCIS LANGLOIS, CITOYEN
La Presse (3 décembre 2024) nous apprend que le ministre de la Santé, Christian Dubé, imposerait aux nouveaux médecins formés au Québec, sous menace de très lourdes amendes, de servir cinq ans dans le système public avant de pouvoir travailler au privé.
Nous y voilà donc. La logique d’État suit son cours et le sauveur d’un système lézardé de partout sous les contraintes de ses incitatifs distordus doit maintenant recourir à l’autoritarisme nu pour projeter une illusion d’action.
Autoritarisme parce que la création d’un système universitaire subventionné n’avait jamais été conditionnelle à l’obéissance des bénéficiaires aux volontés de l’État. C’est un précédent grave que créerait le ministre en passant du principe s’énonçant « les Québécois paient des impôts pour que des Québécois puissent s’instruire » au sophisme autocratique : « c’est l’État qui paie les études, donc c’est lui qui décide de ce que font les étudiants. » (Ce dernier, d’ailleurs, mal caché derrière le slogan éculé « redonner aux Québécois », comme si les médecins du privé servaient des Martiens et payaient leurs impôts au Népal.) L’idée même de n’avoir qu’un seul employeur autorisé (et obligatoire!) est choquante. Les droits humains élémentaires en sont écorchés. Et si on comptait contester cette loi sur la base de l’une de nos chartes, ce serait oublier le traitement cavalier de celles-ci par le gouvernement Legault.
La mesure n’est, d’autre part, qu’une illusion, puisqu’elle ne résout rien. Si le système public manque de médecins, c’est à ses gestionnaires d’agir comme le font tous les employeurs de tous les pays libres : trouver les bons incitatifs pour les attirer. Dans dix ans, quand les meilleurs médecins quitteront ce système qui ne sait retenir son personnel autrement que par la force, quelle sera la solution du gouvernement? Ajouter un autre cinq ans de conscription aux nouveaux médecins? Ou quelque chose de pire encore?
Mais l’illusion recherchée ici procède d’un expédient vieux comme le monde : celui du bouc émissaire. Depuis au moins une dizaine d’années, il semble politiquement très rentable de faire porter aux médecins, groupe rendu impopulaire, le poids des problèmes structurels du système de santé. Pourquoi, par exemple, les gouvernements successifs demandent-ils de moins en moins d’élèves par enseignant, mais de plus en plus de patients par médecin? Pourquoi voit-on périodiquement apparaître quelque article évoquant le dévouement des médecins de campagne d’autrefois, accourant au milieu de la nuit au chevet de leurs patients, alors qu’on ne voit jamais la nostalgie correspondante pour la maîtresse d’école de village avec 40 élèves dans sa classe groupant sept niveaux?
Une réponse tentante est que la profession médicale est devenue une profession de femmes mais dont la représentation mentale est encore masculine. La misogynie refoulée y détecte immédiatement une cible facile. Autre réponse tentante : les médecins sont classés comme « riches ». Le réflexe populiste leur rend donc un sourd verdict de culpabilité, les jetant sur la défensive à la moindre protestation de leur part. Qu’importe si les critiques n’auraient jamais eu le courage de passer à travers tant d’années d’études au contenu écrasant et à la discipline implacable : la compensation monétaire de ceux qui ont ainsi formidablement investi en eux-mêmes deviendra un prétexte d’indignation factice aux boutefeux de service.
La démagogie flagrante du ministre Dubé est pourtant énoncée avec sérieux. On peut craindre que notre système de santé soit ainsi entré dans une phase critique de sa dégradation. L’avenir est inquiétant.
— Francis Langlois, Montréal.